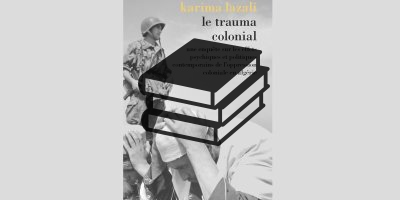Depuis le 14 janvier 2011, date du départ de Ben Ali, la Tunisie a connu en tout et pour tout 551 jours sans état d’urgence (en majeur partie entre mars 2014 et juillet 2015). Son instauration, son prolongement ou ses quelques suspensions n’en finissent plus, dessinant un mode de gouvernement en perpétuelle variation. Sa durée initiale fixée à trente jours se voit largement prolongée chaque fois que l’État en ressent le besoin, en faisant vivre à crédit l’hypothèse d’un retour à la normale, comme complément de la fiction usée d’une transition politique un jour achevée, ou de celle d’une économie qui sortirait du tunnel.
Contrairement à l’Égypte, où l’ancien régime a maintenu en vigueur l’état d’urgence pendant près de trente ans, avant de voir le mouvement révolutionnaire l’abolir un temps, l’État tunisien n’avait eu recours à ce type de décret que pour des périodes limitées. Le décret réglementant cet état d’urgence date de janvier 1978, et entre aussitôt en vigueur alors que le pays connaît une grève générale le 26 janvier. En décembre 1983 il est de nouveau employé lors d’un autre mouvement massif de contestation, désigné comme « l’émeute du pain » dans la mesure où il est lié à l’augmentation des prix sur les produits céréaliers, à la suite d’un plan d’austérité imposé par le FMI.
Dans les deux cas, les révoltes ont été durement réprimées, l’armée a été employée contre les manifestants en complément de la police et le nombre de morts lors de ces événements est toujours incertain. En dehors de ces périodes, le contrôle permanent, l’arbitraire policier et sa violence constituaient cependant bien un mode de gouvernement permettant d’étouffer les tensions sociales et de maintenir l’ordre, selon des dispositions qui pouvaient frapper n’importe qui, mais plutôt de manière individuelle. Il appartenait à la nouvelle démocratie de rendre quasi-permanent un état d’urgence qui permet d’agir autant en masse qu’en détail, en en faisant l’horizon indépassable du moment.

À la différence d’autres situations dans le monde, où le terrorisme est le principal mobile pour mettre en place des mesures dites exceptionnelles, avant de voir ces mesures êtres appliquées dans bien d’autres champs, le cas tunisien témoigne lui du fait que c’est d’abord l’instabilité sociale et politique qui est visée, avant de mobiliser le terrorisme comme argument pour sa prolongation infinie.
En dehors de la chronologie qui l’atteste suffisamment, cette dimension transparaît dans de nombreux aspects de la mise en place de ces mesures. Ainsi la limite du couvre-feu n’a jamais été aussi restreinte – à partir de 17h - qu’à la suite de mouvement de contestation de janvier 2011 ou après un mouvement de chômeurs parti de Kasserine en janvier 2016, se trouvant chaque fois généralisée à tout le territoire. Alors que suite à une attaque à l’explosif dans la capitale en octobre 2015 par un groupe d’inspiration jihadiste, il n’est applicable qu’à partir de 20h et limité à la seule agglomération de Tunis. Les pouvoirs accrus accordés à toutes les forces de répressions et les interdictions multiples qui les accompagnent visent à renvoyer tout le monde chez soi et à reprendre en main l’ordre des choses. En tant que tel, l’état d’urgence apparaît comme un processus de normalisation, dans une période où l’autorité de l’État s’est trouvée largement contestée.
Par rapports aux lois ordinaires, le décret réglementant l’état d’urgence offre aux autorités des prérogatives renforcées. Il permet notamment « d’interdire toute grève ou lock-out même décidés avant la déclaration de l’état d’urgence », interdiction qui s’accompagne de la possibilité de réquisitionner les personnes et les biens pour assurer « le bon fonctionnement des services publics et des activités ayant un intérêt vital pour la nation. », mais également de « réglementer les séjours des personnes » dans certaines zones de manière générale, et plus précisément de « toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Cette disposition peut s’appliquer notamment par des assignations à résidence ou par le biais de perquisitions, de jour comme de nuit, sans autorisation préalable. « Les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre » peuvent être interdites et les « lieux de réunion de toute nature » fermés. Au passage, les médias peuvent être contrôlés et censurés – ce qui ne s’avérera pas si nécessaire depuis que ceux-ci rivalisent à nouveau pour être le meilleur lèche-bottes du régime.
Sur plusieurs années d’état d’urgence, l’application de ces mesures a beaucoup varié dans le temps et selon les situations. Une fois que les mouvements de protestation ont connu un certain reflux et que la police s’est remise de sa défaite momentanée, les autorités ont pu plus librement tirer profit de ce décret. Ainsi les perquisitions de jour comme de nuit, trop longtemps associées à l’ancien régime sont massivement de retour : après l’énième proclamation de l’état d’urgence en novembre 2015 — depuis laquelle il a été prolongé sans interruption — le ministère de l’Intérieur en décompte 3000 dès les deux premières semaines, ayant abouti à 306 arrestations (c’est-à-dire une moyenne d’environ 200 perquisitions et une vingtaine d’arrestations par jour). Mais ces coups de filets massifs ne s’arrêtent pas immédiatement après cela, à un tel point que les communiqués mêmes du ministère deviennent sujets à caution, l’énormité des chiffres laissant parfois planer un doute — 593 personnes arrêtées pour la seule journée du 18 décembre 2015, 1142 arrestations de « personnes recherchées » pour la seule nuit du 22 au 23 décembre qui suit ! Il n’est pas impossible que l’exagération serve à justifier l’état d’urgence, où le nombre d’arrestations massives est exhibé comme seul résultat, ou en tout cas participe à la construction d’une menace potentielle au sein de la population. Les mouvements de protestation se voient directement sanctionnés par chaque nouvelle promulgation : le jour suivant l’annonce de l’état d’urgence en juillet 2015, un sit-in se tenant depuis le 31 mai est violemment dispersé dans la zone industrielle de Gabes. Ailleurs, des militants ont droit à des perquisitions, et à défaut de preuves pour terrorisme, certains écopent en première instance de condamnation pour possession de drogue – ce qui est sévèrement réprimé par un an de prison ferme et une lourde amende en Tunisie, ce délit constituant un outil habituel de gestion des populations improductives.
À ces mesures prévues viennent s’ajouter d’autres dispositions diverses, en particulier sur le contrôle des frontières et des migrations. En juillet 2015, une mesure sans fondement juridique interdit ainsi les tunisiens de moins de 35 ans de se rendre dans tout pays arabe ou en Turquie sans autorisations du père. Cette mesure justifiée par la volonté d’empêcher les jeunes de rejoindre des « groupes extrémistes » à l’étranger consacre à nouveau l’idée d’une population qui reste jeune très longtemps, éternellement mineure et toujours considérées comme dangereuse. De même, la construction d’une barrière de sécurité à la frontière avec la Libye, visant à se transformer en mur avec le soutien financier de nombreux gouvernements européens, est aussitôt entamée. Ce dispositif semble bien dérisoire face aux menaces terroristes qui sont sensées le justifier, mais il prend tout son sens dans une politique de renforcement du contrôle des frontières, bien plus efficient à l’endroit des opérations de contrebande et des traversées illégales de migrants. Des recommandations préconisent également de réinstaurer la police universitaire, abolie au lendemain du 14 janvier 2011, afin de surveiller étroitement les campus, ce contre quoi étudiants et enseignants se sont pour le moment vigoureusement opposés.
Une nouvelle loi antiterroriste apparaît aussi comme pérennisation de certaines mesures de l’état d’urgence. Sans trop entrer dans les détails, après la révolution, la loi antiterroriste de 2003 pouvait difficilement être employée en l’état, tant elle était ouvertement associée à tous les forfaits du régime qui a abondamment recouru à la qualification terroriste pour emprisonner n’importe qui. Sans être abrogée, l’ébullition qui traversait le pays rendait la loi relativement inapplicable, elle fut comme suspendue par la révolution, avant de se voir progressivement réhabilitée et employée. La loi adoptée au milieu de l’été 2015, justifiée par un carnage à l’arme lourde sur une plage, est assez similaire de bien des législations antiterroristes dans le monde : le cadre définissant les infractions terroristes est très flou pour une application d’autant plus ample. Sont terroristes les actes ou les intentions dont le but serait de « contraindre indûment un État ou une organisation internationale à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire » ou de « porter préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics ». La loi comprend entre autres un délit d’apologie du terrorisme, autorise une prolongation de la garde à vue pour les affaires liées au terrorisme allant jusqu’à quinze jours - contre six auparavant - et cela au secret, sans que l’accusé ne puisse joindre avocat ou proches. Par ailleurs, elle réintroduit des sanctions drastiques, pouvant aller jusqu’à la peine de mort dans plusieurs cas (un moratoire avait suspendu ce type de peine en 1991, remplacé par de la prison à vie, qui n’était donc pas mentionné dans la précédente loi antiterroriste de 2003).
Au milieu d’une telle offensive, les accusations d’un retour à l’ancien régime apparaissent bien faibles, semblant tenir sur la fiction désespérée qu’ailleurs, dans des démocraties peut-être plus anciennes, la législation sécuritaires ou les lois antiterroristes préserveraient encore les droits et les libertés. Il faut toute l’illusion téléologique de la démocratie en marche pour penser qu’une réforme de la loi antiterroriste datant de la dictature offrirait nécessairement plus de libertés si elle est votée par des démocrates, ou pour voir dans les mesures sécuritaires considérées comme excessives de simples survivances du passé. Aujourd’hui plus que jamais, il semble vain de prendre pour modèle des démocraties qui usent de la même rhétorique pour faire passer toutes les lois nécessaires afin d’exercer un contrôle renforcé des territoires et populations, qui emploient en partie les mêmes outils de répression et partagent des renseignements ou des pratiques. La menace justifie également le retour de franches collaborations entre services de renseignement et forces de répression au niveau international. Signe des temps de la victoire d’un certain discours faisant admettre la nécessité de cette collaboration sécuritaire : la proposition de l’État français au plus fort de la répression en janvier 2011, alors formulée par la ministre des affaires étrangères Michelle Alliot-Marie, d’une assistance aux forces de l’ordre en termes de formation et de matériel avait redoublé la colère et suscité de larges protestations. Aujourd’hui dirigée contre le nouvel ennemi qu’est le terrorisme, une proposition semblable se voit actée sans remise en cause majeure. Le gouvernement tunisien à la manœuvre ne rate pas une occasion pour dire que de telles législations et mesures doivent justement permettre de sauver la transition démocratique — sinon la démocratie tout court — dans une mise en scène réglée de la démocratie contre le terrorisme où il ne peut y avoir d’autres termes. Ceux dont les preuves d’allégeance envers la lutte antiterroriste sont un peu timides sont ciblés à tous les niveaux, à l’image de ces dix députés qui se sont abstenus lors du vote de la loi antiterroriste - qui aurait voté contre se serait trop ouvertement rangé parmi les ennemis – cloués au pilori en une de tous les journaux. Jusqu’au titre du journal le plus lèche-botte du pouvoir qui s’interroge, entre autres, dans un délire sécuritaire qui se pare d’un discours sur la défense de la démocratie menacée « faut-il attaquer en justice les députés contre la loi antiterroriste ? ».
Si l’état d’urgence apparaît avec le plus d’éclat à travers ces dispositions massives qui frappent indistinctement toute la population, son maintien implique une variation des moyens employés, devenant ensuite plus localisés afin de maintenir la pression sans devenir insupportable pour tous. Ainsi le couvre-feu, qui incarne l’exemple par excellence d’une suspension des règles habituelles et constitue une forme de réaffirmation de la souveraineté dans l’espace où seule la présence de l’État est permise, ne peut durer qu’un temps. Au-delà de ce qu’il empêche, le couvre-feu présenté comme mesure exceptionnelle pour répondre à l’insécurité, produit l’insécurité. L’extérieur tout entier se fait menaçant ; dans les rues - théoriquement – vidées, toute personne qui s’y trouve, où y est aperçue, devient immédiatement suspecte, tandis que le caractère dangereux se voit confirmé par l’action des forces de sécurité qui contrôlent, harcèlent voire tirent sur ceux qui ne respectent pas le couvre-feu. La population est invitée à se méfier d’elle-même, des éléments dangereux qui se trouveraient en son sein, face auxquels l’État serait le seul recours, et ainsi accepte ces mesures sécuritaires qui agissent d’abord sans distinction. Une fois s’être assuré d’une certaines obéissance de diverses fractions de la population par la peur – et il y aurait toute une chapitre à faire sur les discours et dispositifs de l’effroi à la fois comme moyen de polarisation et de paralysie - les mesures massives peuvent être allégées ou localisées, pour ne conserver que des outils permettant de cibler plus étroitement des populations désignées comme dangereuses, trop instables ou facilement en proie à la contestation.
L’état d’urgence ne peut se maintenir qu’en modulant son application, dure contre certains, presque indiscernable pour ceux qui se soumettent à la discipline. Parallèlement à la terreur, il s’agit bien de produire des comportements, et des comportements conformes : les contrôles renforcés de sécurité à l’entrée des magasins et l’interdiction de circulation la nuit tombée ne devaient surtout pas dissuader les consommateurs de faire leurs courses en journée. Après les attaques qui ont visé des touristes il fallait aller en Tunisie cet été pour les vacances (I will go to Tunisia this summer ou Moi j’y vais comme le formulait des campagnes internationales). Ou comment allier la vie sous couvre-feu sans entraver la fête. Divers lieux chics, comme un hôtel du centre-ville ou des clubs situés dans une banlieue huppée de la capitale sont autorisés à organiser des soirées où, couvre-feu oblige, le public ne peut sortir entre 22h et 5h, enfermé dans la fête. Cette gestion de la vie sous état d’urgence cherche perpétuellement à réduire les attitudes non conformes et à en produire d’autres, notamment celles qui participent à sauver l’économie, collaborent avec les forces de sécurité, privées et publiques, affichent leur soutien à la guerre décrétée et acceptent de remettre les grèves à plus tard. Ainsi ces figures qui adoptent des comportements conformes, quel que soit leur avis sur l’état d’urgence, ne perçoivent pas d’enjeu essentiel dans sa prolongation et considèrent que s’il on en est victime c’est que l’on doit bien avoir quelque chose à se reprocher.
Comme partout ailleurs, des mesures et pratiques d’exception sont aussi la règle en certains endroits du territoire, depuis plus longtemps qu’ailleurs. Dans divers quartiers populaires de la capitale, en plus de son application usuelle, des jeunes peuvent se plaindre d’une sorte de couvre-feu informel du samedi soir, qui consiste en un déploiement policier renforcé, contrôlant leur déplacements et les empêchant de traîner dehors. La prégnance des pratiques et de l’imaginaire du couvre-feu maintien à vif la nécessité de voir celui-ci battu en brèche, à l’instar de la politique d’exception qu’il représente, afin de prévenir aussi la distinction qu’il opère entre une population obéissante et une population à contrôler. À ce titre, l’affirmation souveraine qu’il représente peut rapidement se retrouver battue en brèche dès lors que le couvre-feu est rendu inopérant par une présence collective suffisante pour le rendre caduc. Les avertissements du gouvernement annonçant fin novembre 2015 que le couvre-feu sera « cette fois » appliqué « avec sévérité » signalent par leur instance excessive, pour ceux qui n’ont pas vu les épisodes précédents, combien celui-ci n’était souvent que relativement suivi. Ces transgressions du couvre-feu sont autant de gestes communs, d’ailleurs pas nécessairement motivés par une intention protestataire, comprenant autant les passants qui ne désertent pas la ville, ceux qui restent dans les cafés ouverts que des formes diverses de contestation, tel que des manifestations ou des jets de pierres sur la police.
À ce titre, les épisodes révolutionnaires incarnent par excellence une possibilité de le rendre inopérant, jusqu’à le retourner. « Couvre-feu décrété. Pour qui ? Pour la police et l’armée peut-être, qui ont déserté la rue la nuit du jeudi 14 janvier ! Car les manifestants sont toujours là, ils veillent sur la ville [Taoufik Ben Brick, « C’est la révolution des enfants de la balle », Libération, 13 janvier 2011.] . » Un tel renversement n’a pas été général, mais quelque chose a existé, dans des endroits très divers. Les scènes des comités de vigilances de la révolution de 2011 où les manifestants tiennent largement la rue malgré le couvre-feu commencent à s’éloigner, bien qu’elles reviennent ponctuellement ici et là. Leur évocation témoigne néanmoins que la suspension de l’exception posée par les autorités ne correspond pas à un simple retour à la normale, mais tend à constituer « un état d’exception effectif » comme pourrait l’énoncer Walter Benjamin ; un moyen de répondre à la situation, de dépasser les peurs et un moment où se posent les questions de l’organisation collective et de la redéfinition de la communauté.
Encore aujourd’hui, l’état d’urgence a pour effet de suspendre une partie de la contestation, mais peine cependant à l’enrayer véritablement. Malgré les interdictions de défiler, des grèves ou des rassemblements ont bien lieu, et continuent d’advenir. Si la direction de l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) accepte assez sagement d’annuler les mouvements prévus sitôt l’état d’urgence déclaré, elle se voit souvent obligée pour ne pas perdre toute sa légitimité d’accompagner par la suite des mouvements qui sinon seraient de toute manière menés sans son autorisation, et où participent d’ailleurs un grand nombre de ses sections de base. Le soutien en d’autres endroits du pays ou à l’international de conflits souvent ancrés sur un territoire donné prend une importance particulière pour rompre un isolement qui autrement ; permettrait de les réduire rapidement au silence par l’usage de l’ensemble des mesures permises par l’état d’urgence. Ce type de solidarité a pu ainsi participer au printemps à rompre l’état de siège dans lequel se trouvaient les îles Kerkennah, quand suite au blocage des sites pétroliers et à la contestation qui s’y déroulait l’État a répondu par une occupation policière et un siège de l’archipel.
L’inscription de certaines dispositions de l’état d’urgence dans la loi ou les diverses mesures et dispositifs que peuvent toujours mettre en place les gouvernements successif invitent à ne pas trop s’attacher à sa forme présentée comme temporaire, mais toujours à son fonctionnement et à l’ordre qu’il participe à instaurer. Le retour à la normale promis, toujours à venir, et réclamé par les mouvements démocrates ou les organisations des Droits de l’Homme paraît peu enviable si l’on considère qu’aux yeux de ceux qui l’ont déclaré l’état d’urgence pourra en effet être suspendue quand la situation aura été assez normalisée. En revanche, le déroulé de ces dernières années en Tunisie, ainsi qu’un certain nombre d’événements ailleurs, témoigne du fait que sa suspension par les mouvements de protestations ne donne pas lieu à un tel retour, mais à une interruption du cours de choses qui ouvre des périodes d’expérimentations sociales et politiques s’accompagnant d’une remise en cause profonde des appareils de gouvernement.