Le corps des femmes marocaines est l’objet de tous les fantasmes, produits d’une culture coloniale construite par les images. Dans la première moitié du XXe siècle, des cartes postales érotiques mettant en scène des femmes marocaines – mais aussi des femmes d’autres colonies – sont massivement diffusées. Ce sont, pour les soldats et les touristes occidentaux, des souvenirs qu’ils envoient à leurs amis ou leur famille restés au pays. L’immense majorité des destinataires de ces cartes n’est jamais allé et n’ira jamais aux colonies. La distance facilite encore le fantasme. Ces images construisent un imaginaire colonial de la liberté sexuelle et des corps disponibles : les femmes sont dévêtues, dans l’attente de l’homme blanc. La mauresque aux seins nus s’envoie par la poste, sans enveloppe. Ce sont des images publiques ; elles ne sont ni cachées ni censurées, contrairement aux photographies érotiques mettant en scène des femmes blanches. Le corps colonisé n’est pas soumis au même traitement que le corps blanc : on l’exhibe, on le touche, on se l’approprie ; il appartient au colon.
DE L’IMAGE AU RÉEL
C’est sous couvert d’ethnographie que ces images circulent : on instrumentalise les catégories ethniques, on prétend montrer la réalité des corps et de la vie des pays colonisés à celleux qui n’y sont pas. Les cartes postales sont titrées de pseudo-catégories de population – ici, « type de jeune marocaine » - tandis que vingt ans plus tôt, le docteur Jacobus X décrivait tour à tour dans l’Art d’aimer aux colonies les anatomies et sexualités particulières d’une « petite fille Annamite » de Cochinchine, de la « femme Kmer » au Tonkin, des « dames créoles » et de leur « humeur badine », des « mulâtresses » guyannaises, de la « négresse martiniquaise » ou de la « jeune fille Kassonké » du Sénégal.
« La sexualité des colonies n’est bridée par aucun tabou, y compris celui de l’enfance : les images proposées exhibant souvent des jeunes filles non-pubères (ainsi, bien que plus rarement, des jeunes garçons) dans des mises en scène fortement sexualisées. La violence des fantasmes projetés sur les populations colonisées est donc sans limite, puisque le corps de l’ « Autre » est lui-même placé en dehors du champ licite des normes, plus proche de l’animal et du monstre que de l’humain, plus en affinité avec la nature qu’avec la culture. Ceci explique pourquoi le corps de l’« Autre » est pensé simultanément comme symbole d’innocence et de dépravations multiples : un corps qui excite autant qu’il effraie. Dans ce contexte, les femmes « indigènes » sont ainsi revêtues d’une innocence sexuelle qui les conduit avec constance au « péché » ou à une « dépravation sexuelle atavique » liée à leur « race » : tout ceci confortant la position conquérante et dominante et du maître et du colonisateur » [1].
C’est tout un appareil iconographique et textuel qui au XIXe siècle, constitue la propagande coloniale : cartes postales, photographie, littérature pseudo-scientifique, puis érotique, auxquelles s’ajoutent les zoos humains - qui naissent à la fin du Xve siècle et se popularisent au XIXe siècle avec les expositions universelles. Ces dispositifs culturels, en créant un imaginaire de l’Autre primitif, inférieur, débridé, justifient la colonisation. Le mythe de l’altérité est aussi liée à l’invention de la race, soit la classification des humains par la généalogie, par l’observation de critères physiques transmissibles [2]. Ce sont les naturalistes européens, parmi lesquels Buffon et Linné qui, les premiers, établissent des taxonomies raciales au début du XVIIIe siècle, théories qui deviendront dès la seconde moitié du siècle, « indissociables des dispositifs visuels destinés à les représenter » [3].
« Le racisme scientifique, la mobilisation de la notion de « race » en tant qu’objet de savoir et fondement de pratiques de pouvoir, serait caractérisé dès son origine par une essentialisation des différences » [4].
La classification raciale oppose le blanc et les autres. Le discours scientifique ou pseudo-scientifique s’accompagne d’une iconographie qui objectifie, exotise, fétichise, pornifie [5] les corps des indigènes. Elle légitime la prostitution, la pédophilie – les plus jeunes aimées de Bousbir avaient douze ans - et l’appropriation des femmes par les colons qui les prennent comme amantes. La sexualité coloniale ne se restreint pas, en effet, à la prostitution : ce sont aussi des relations conjugales et amoureuses - le plus souvent entre hommes blancs et femmes racisées - et dont on peut interroger la réciprocité au regard de la position de pouvoir qu’occupent les hommes blancs. Le viol colonial est légitimé par la position de pouvoir qu’occupent les colons et par le mythe de l’infériorité des colonis.é.e.s.

Bousbir est un produit de la culture visuelle coloniale. Cette ville-bordel répond à l’imaginaire blanc de la femme indigène lascive, aux mœurs et à la sexualité forcément débridés, au corps toujours nu et à l’anatomie nouvelle. Ces femmes posent, parées parfois d’accessoires « exotiques » qui attestent de l’authenticité de la photographie. Le plus souvent, elles sont représentées en intérieur, dans les lieux clos que sont la chambre ou le studio du photographe. Leurs homologues masculins, eux, apparaissent majoritairement en extérieur : ils posent dans la rue ou devant des éléments naturels, paysages à visiter ou à imaginer. Le paysage, dans le cas des femmes, c’est elles. Leur corps est un territoire à explorer. De ces mises en scènes naissent des imaginaires, et des imaginaires naissent des lieux. La création de Bousbir répond aussi à une demande marchande : la fantasme généré par les cartes postales érotiques coloniales devient un marché, les blancs des clients qu’il faut satisfaire. Les colons désirent des images, le Capital leur donne vie. Un lieu dédié à la prostitution qui rejoue et incarne le fantasme colonial. L’iconographie « fabrique des mondes », pour reprendre les mots de Pascal Blanchard [6] : des mondes imaginaires qui deviennent tangibles et produisent à leur tour des images. Cette carte postale de « jeune marocaine » dont on exhibe vulgairement le sein, n’existerait pas sans les photographies et les cartes qui lui ont précédé. Elle est l’un des outils de la marchandisation des corps, alliée au désir, à la potentia gaudendi [7] qui l’a fait naître et qu’elle génère. Cette image – et non la jeune femme qu’elle représente – est le produit du désir objectivant des colons sur les femmes racisées. À son tour, elle excite les passions de ceux qui la regardent. Ce qu’elle veut, c’est être désirée. Dans Que veulent les images ? William John Thomas Mitchell analyse une scène du Videodrome de David Cronenberg, à ses yeux la parfaite illustration de la réciprocité de désir entre le regardeur et la piction [8]. « On y voit le visage de Max Wren (James Woods) s’approcher d’un poste de télévision déformé par la bouche de sa nouvelle amante, Nicki Rand (Deborah Harry), qui l’interpelle en ces termes : « Viens avec moi, viens voir Nicky ! » [9]. À l’image de Nicky incarnée par le poste de télévision, ce que veut le portrait de la « jeune marocaine », c’est nous. « Max, I want you ! » [10] . Elle appelle l’homme blanc, sans qui elle n’existerait pas, à coloniser son pays et son corps. Le désir des colons fait des corps des images qui appellent d’autres blancs ; les images engendrent Bousbir, ville factice de consommation qui, à son tour, alimente l’iconographie coloniale en produisant des images pour se promouvoir.
La domination coloniale est d’autant plus forte qu’elle annihile la volonté des colonisé.e.s : elle les confond avec les images, elle leur attribue un désir qui n’est pas le leur, et qui légitiment la violence sexuelle des colons à leur encontre.
FASCINATION / RÉPULSION
Le regard que porte les occidentaux sur les peuples colonisés est toujours ambigu : il oscille entre fascination et répulsion, désir et dégoût, entre l’attrait d’un inconnu exotique et la peur de l’Autre
Les relations entre colons et colonisées sont toujours illégitimes – les aimées régulières ne pouvaient être que blanches – et les enfants qui naissent de ces unions sont mal acceptées. Le métissage est en effet perçu comme une dégénérescence, un danger pour la « race blanche » en même temps qu’un adoucissement des individus racisés, à qui le colon donne un peu de sa civilisation. C’est tout le paradoxe de la domination coloniale, qui condamne en même temps qu’elle tolère des sexualités contraires à la morale, tant qu’elles ont lieu ailleurs.
« Ainsi, le « gigantesque lupanar » figuré par la domination esclavagiste et coloniale permet-il aux colonisateurs de se penser et de se vivre en maîtres dans des espaces où les possibilités sexuelles sont maximisées au regard des normes et des interdits de leurs propres sociétés tout en excluant leurs femmes de ce même droit. Ceci explique pourquoi les pratiques sexuelles, amoureuses et conjugales se superposent, presque partout, aux règles, aux décrets et aux lois édictés par ceux-là même qui les transgressent allègrement et continuellement » [11].
Aux colonisé.e.s, on associe l’animalité, la lascivité ; on attribue une anatomie « anormale », toujours signe d’une sexualité perverse – masturbation, saphisme, prostitution – et insatiable. Ce qui effraie aussi, ce sont les maladies vénériennes - que l’on attribue, bien sûr, aux prostituées, mais jamais à leurs clients : la sexualité n’est sale que chez l’Autre. Pour répondre aux craintes sanitaires et morales que posent la sexualité interraciale, la France instaure un système prostitutionnel « utilitaire » et contrôlé, à destination des hommes blancs. Ainsi naît Bousbir, quartier réservé à la prostitution, enceinte fortifiée de 160 mètres sur 150 ; une seule entrée. Les prostituées qui y vivent et y travaillent doivent se soumettre à des contrôles de santé réguliers. Surtout, elles doivent être inscrites comme « filles soumises » auprès de la police des mœurs, qui contrôle aussi leur mobilité géographique [12]. C’est un lieu de divertissement pour les hommes blancs, d’enfermement et de surveillance pour les femmes marocaines qui doivent témoigner de leur bonne santé pour franchir la porte du quartier. Ce dispositif de contrôle sanitaire protège les clients, mais pas les prostituées, qui sont au contraire incriminées pour les maladies qu’elles pourraient propager. Fautives par nature.
QUE FAIRE DES IMAGES ?
La publication récente de l’ouvrage Sexe, race & colonies, la domination des corps du Xve siècle à nos jours [13], co-dirigé par les historien.ne.s Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Christelle Taraud et Dominic Thomas, suscite un vif débat. L’ouvrage entend retracer six siècles d’histoire coloniale à travers les images : il en publie pas loin de 1200. Certaines sont pornographiques, d’autres érotiques, toutes sont le produit et le moteur de la domination coloniale. Ce qu’elles montrent, plus ou moins explicitement, c’est l’objectivation des indigènes, la violence sexuelle et la toute-puissance des colons. Doit-on ou peut-on montrer ces images ? Peut-on rendre visible l’oppression coloniale sans les images ? Ne pas les montrer revient-il à les cacher, et à cacher cette histoire violente ? À qui appartiennent ces images ? Et comment les montrer ?
L’une des questions que soulèvent les critiques, c’est celle de la légitimité. Qui peut prendre la responsabilité de diffuser des images d’une telle brutalité ? Elles sont des documents historiques éclairants, mais les corps qu’elles montrent sont des individus réels qui ont vécu au delà des images, et dans lesquels peuvent se reconnaître les victimes du racisme d’aujourd’hui. D’aucun.e.s suggèrent qu’elles devraient être « restituées aux communautés qui ont subi ces agressions » [14], que le droit de les diffuser ou non revient à leurs ayants-droits ou à celleux qui souffrent encore des conséquences du racisme colonial ; d’autres – parmi lesquels les co-directeur.ice.s de l’ouvrage – défendent une distance inhérente au travail d’historien.ne. Il est à noter que si parmi les quatre-vingt-dix-sept contributeur.ice.s, il y a des chercheur.euse.s et écrivain.e.s qui sont aussi racisé.e.s, héritier.e.s de cette histoire coloniale, les 5 co-directeur.ice.s de l’ouvrage sont blanc.he.s : quatre hommes et une femme. C’est Pascal Blanchard, historien-chercheur au CNRS, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations, qui est le plus médiatisé : invité seul chez Médiapart, France 24, Le Média, parfois aussi le seul directeur nommé dans les articles de presse. Bien que sa connaissance du sujet soit indéniable – il travaille sur la colonisation française depuis 25 ans – la place particulière qui lui est réservée est peut-être à questionner. La journaliste Leïla Aalouf et le collectif Cases Rebelles parlent d’appropriation blanche d’une histoire et de ses souffrances, et questionnent la hiérarchie dans la conception du livre.
« […] en se réappropriant un travail déjà existant et en se présentant comme une voix scientifique exclusive, la direction du livre contribue à invisibiliser les collaborateurs non blancs de ce travail collectif. Qu’est-ce que la colonisation, sinon la domination des corps et son appropriation ? » [15]
« La réalité, c’est le désir monstrueux de la suprématie blanche et ses réseaux de diffusion de vouloir être la voie principale, autorisée, organisatrice sur la question de nos souffrances, et d’en être les bénéficiaires, symboliques et réels ». [16]
Pascal Blanchard le dit lui-même : qu’il soit un homme blanc facilite aussi son travail de recherche et sa diffusion [17]. Il admet aussi qu’il ne peut pas y avoir que des blancs pour raconter les histoires des colonisé.e.s, mais que son travail, et celui d’autres chercheur.euse.s a aussi permis d’ouvrir la voix à d’autres. Est-ce le rôle des privilégiés d’amener à la lumière ce qui était caché, pour que les autres, celleux qui n’ont pas le luxe de la crédibilité, puissent s’exprimer à leur tour ? Le risque serait alors de maintenir une hiérarchie raciste entre l’homme blanc précurseur et les autres, qui arrivent toujours après. Ceux qui découvrent, ce sont les blancs. Bien que la recherche historique induise une certaine distance avec l’objet étudié, bien qu’elle s’appuie sur des faits et qu’elle tende à l’objectivité, elle n’est jamais neutre : l’historien.ne n’est pas étranger.e à l’histoire qu’iel décrit : iel l’écrit. Au delà de la légitimité pour les un.e.s et les autres d’étudier ou de diffuser ces images, il est peut-être aussi question d’établir des priorités. Sans doute aurait-il été préférable que ce soient les contributeur.ice.s racisé.e.s de Sexe, race et colonies qui dirigent sa conception et qui soient invité.e.s dans les médias pour en parler. C’est en tout cas la question que posent ses détracteurs.
Republier les images permettrait, nous disent les directeur.ice.s, de « dévoiler » une histoire méconnue, ce à quoi le collectif Causes Rebelles répond :
« Nous, descendant.e.s de colonisé.e.s et porteur.se.s de cette histoire, n’avons jamais eu le luxe de « méconnaître » la violence sexuelle coloniale, ses traumas, ses persistances ou ses réminiscences !
Cette violence est dans nombre de nos œuvres qui parlent de l’esclavage dans les Caraïbes ou aux États-Unis.
Oui, elle est dans nos littératures, nos films, nos corps. Mais elle se trouve également dans maintes autres représentations coloniales (dessins publicitaires, peintures, cinéma, etc.) que l’espace occidental nous recrache régulièrement au visage. » [18].
Mais alors, à qui s’adresse le livre ? Si l’histoire coloniale est déjà connue de ses descendant.e.s et présente dans leurs œuvres, c’est peut-être les blanc.he.s, héritier.e.s des colons, qui l’ignorent. La vocation de Sexe, race et colonies serait alors celle de dévoiler aux blanc.he.s qui ne le sauraient pas encore – ou qui voudraient l’oublier - l’histoire des violences racistes et leurs résonnances contemporaines.
« Que les images aient été connues ou pas, personne ne pourra plus dire, en France et ailleurs « nous ne savions pas ». C’est cela qui fait l’aspect exceptionnel de cet ouvrage. De facto, qu’on l’accepte ou non, ce choc visuel oblige à voir » [19].
Les images, ici, sont des documents historiques : non pas seulement des illustrations, mais le cœur du travail scientifique. Le but de l’ouvrage est de montrer que la domination s’opère par les images, en construisant de concert avec les discours, une dichotomie blanc/Autre, civilisé/sauvage, moral/pervers, une propagande coloniale qui justifie l’occupation des territoires et l’appropriation des corps. Nous ne pouvons pas, nous disent les co-directeur.ice.s de l’ouvrage, nous passer des images pour comprendre leur influence : les montrer serait aussi rendre visible l’histoire violente qu’elles portent. Mais ces images étaient déjà publiques, largement diffusées durant la colonisation. Puisqu’elles n’étaient pas des images cachées, comment leur re-publication peut-elle révéler ? La distance temporelle suffit-t-elle à visibiliser la violence, sans la reproduire ?
« La seule image qui possède la force de transformer la violence en liberté critique, c’est l’image qui incarne. Incarner, ce n’est pas imiter, ni reproduire, ni dissimuler » [20].
Incarner, écrit Mondzain, c’est donner parole à une chair. Les prostituées de Bousbir, sur les cartes postales qui les exhibent, sont désincarnées : elles sont figures uniformes des dominées, sans identité, parfois presque sans visage – ce que l’on voit, c’est d’abord leurs corps. C’est peut-être le texte qui entoure les images qui redonne une voix à ces corps. Car il faut rappeler que Sexe, race et colonies n’est pas seulement un livre d’images, mais surtout un livre d’histoire : son contenu textuel, issu de la recherche de nombreux.ses spécialistes, contextualise les images et permet de les comprendre. Seulement, cet appareil critique n’est peut-être pas, comme l’affirme Christelle Taraud, l’une des co-directrices de l’ouvrage, indissociable des images. L’image se lit plus vite que les textes. Surtout, elle apparaît aussi hors du livre, séparée de l’écrit qui éduque les regards.
« […] la caractéristique fondamentale de l’image, c’est son immédiateté, sa résistance primitive à la médiation. On a pris l’habitude d’appeler médiatique tout ce qui s’adresse à un public par la voie d’un canal et l’on en induit que tout est canalisable. L’image ne l’est pas. Elle déborde largement le canal et s’en va envahir par ses propres ruses les corps et les esprits que nos canaliseurs croyaient maîtriser » [21].
La militante féministe et antiraciste Mélusine [22] questionne l’existence médiatique du livre et la diffusion de ses images dans la presse :
« D’ailleurs, aucun des journaux, étonnement nombreux, qui couvrent la sortie de Sexe, race et colonies ne manque l’occasion de publier de nouveaux clichés, venant illustrer les papiers très sérieux qui expliquent gravement que, au temps des colonies, les hommes blancs diffusaient dans tout l’empire des images outrageantes des corps de femmes indigènes. Et aucun ne paraît comprendre que, ce faisant, ces photographies s’inscrivent dans leur vocation originelle et continuent de la servir : elles sont toujours les cartes postales qui voyageaient, sans enveloppe, de mains en mains, en métropole » [23].
Dans les journaux et les magazines, en Une, dans les kiosques, sur les fils d’actualité : les images s’imposent aux spectateur.ice.s massivement, sans prévenir et sans l’appareil critique qui permet de les déconstruire. Celleux qui voient ne lisent pas toujours. Sortis de l’intimité du livre, les corps sont de nouveaux exposés à tous les regards, sans avoir gagné la parole. Cases Rebelles suggère que les images – dans le livre comme dans la presse – auraient pu être anonymisées, floutées, dépornographiées, désexualisées. Mélusine, elle, propose un recadrage sur les visages pour rendre leur humanité aux sujets photographiés, solution déjà adoptée par Safia Belmenouar et Marc Combier pour l’exposition Bons baisers des colonies aux Rencontres d’Arles [24] en 2018 : les portraits recadrés de deux indigènes, agrandis sur des grandes cimaises, accueillaient les visiteur.euse.s.
« L’image ne produit aucune évidence, aucune vérité, et ne peut montrer que ce que produit le regard que l’on porte sur elle. L’image attend sa visibilité de la relation qui s’instaure entre ceux qui la produisent et ceux qui la regardent. En tant qu’image, elle ne montre rien. Si elle montre décidément quelque chose, elle communique et ne manifeste plus sa nature d’image, c’est-à-dire son attente du regard » [25].
La question que soulèvent les articles sur Sexe, race et colonies – critiques ou non –, c’est aussi celle du contexte : comment montrer les images ? L’ouvrage, remarquent plusieurs journalistes, pèse près de 4 kilos. C’est un beau livre : papier couché, images agrandies, parfois en pleine page ; il est cher – 65 euros [26] - ; il fera un beau cadeau de Noël. La première de couverture aussi dérange : les néons évoquent plus volontiers les red lights amstelodamoises que les bordels coloniaux. Une référence à l’artiste Valérie Oka et à son œuvre Tu crois vraiment que parce que je suis noire je baise mieux ? [27], répondent Pascal Blanchard et Christelle Taraud [28]. Des néons et du texte dans les deux, mais manuscrit chez Oka, en décalage avec la référence porno-chic du matériau. Ici, le mot « sexe », très imposant, en appelle à notre imaginaire fantasmatique : il nous invite à ouvrir le livre comme on franchirait la porte d’un bordel, entre crainte et désir. Nicki, c’est lui.
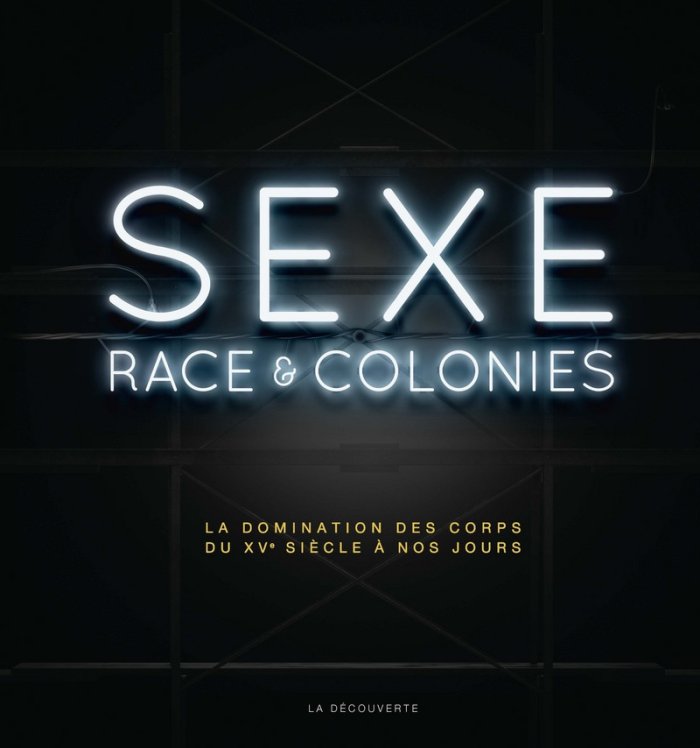
Le format du livre et des documents iconographiques insiste sur l’importance de ces derniers dans l’établissement d’une culture coloniale, puis dans la recherche historique.
« […] ne plus regarder ces images comme périphériques, mais bien comme des sources informatives centrales pour la compréhension du système colonial » [29].
Mais ces choix formels prennent aussi le risque d’esthétiser la violence, voire d’érotiser encore les corps indigènes. Ce que reprochent, au fond, les détracteur.ice.s de Sexe, race et colonies, c’est son manque de pudeur. Il y aurait sûrement d’autres systèmes à inventer – un autre choix de papier, de mise en page, de format, etc - pour que leur vision n’inspire plus la fascination mais la conscience froide des violences racistes et sexistes, pour que ces photos ne soient plus de belles images – aussi dérangeantes soient-elles – mais uniquement des documents, les témoins de l’histoire coloniale et l’alerte contre des violences actuelles.
Solène Langlais est graphiste. Elle travaille notamment sur la relation qu’entretiennent images et normes sociales.






