Il est parfois des points de vue sur la vie qui sont en même temps des points de vue sur la ville. Ce texte est la synthèse de la première partie des Carnets du sous-sol de Dostoïevski. Il a été écrit comme s’il s’agissait d’un système de pensée en image. Vous pouvez aussi le lire comme s’il s’agissait d’une introduction à Nietzsche. Quoi qu’il en soit, on trouvera ici la topologie imaginaire d’un homme « méchant ». Et cette topologie est, de part en part, une pensée. Si certains y voient les éléments d’une critique de la cybernétique en plein XIX° siècle, nous nous contenterons de rappeler que les Droits de l’Homme et du Citoyen garantissent la liberté d’expression, y compris pour les flagrants délits d’anachronismes.
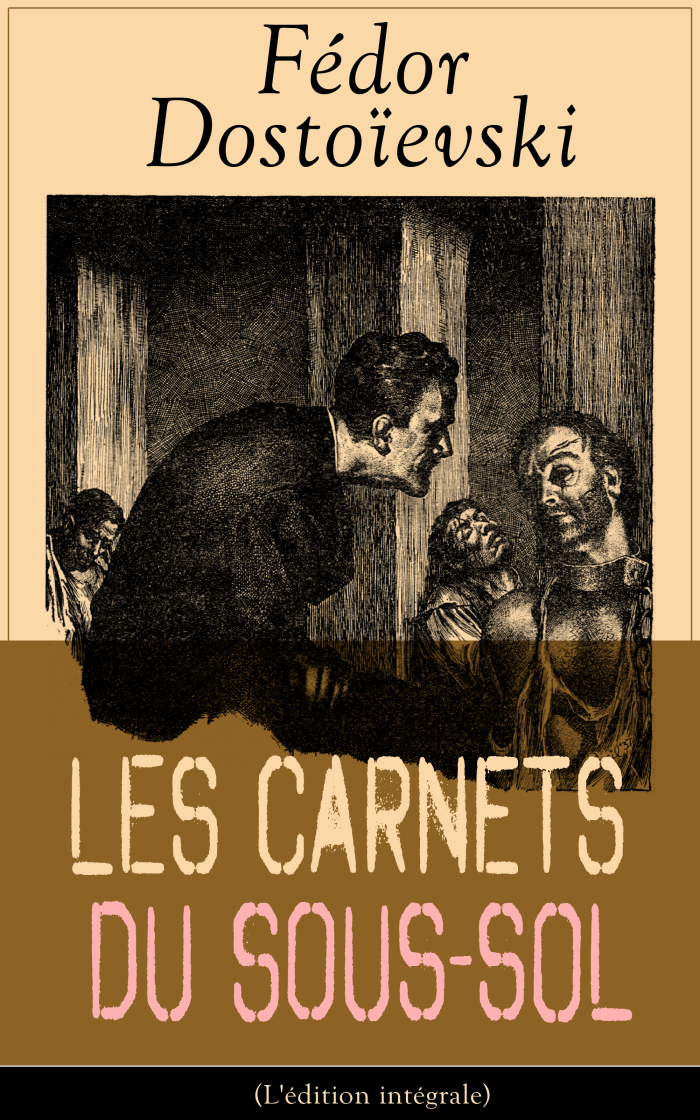
Il est des villes préméditées et d’autres spontanées. Des villes abstraites, et d’autres indécises. Ces dernières sont produits de la vie, quand les préméditées sont les produits du mur. Qu’est-ce que le mur ? Pour le comprendre, il faut d’abord comprendre les deux rapports au mur que sont les deux manières d’être homme. Coupons l’espèce humaine en deux : soit l’homme conscient distinct de l’homme agissant. Le premier nous l’appellerons l’Insecte, le second le Taureau. Humanité d’Insectes et de Taureaux. Pour l’homme qui pense (« nous qui pensons »), pour l’Insecte, le mur est un obstacle. Il sert de prétexte à rebrousser chemin et puis se perdre. Pour l’homme qui agit (« hommes spontanés et hommes d’actions »), pour le Taureau, dont la devise est droit au but, et qui s’apparente au fonceur, le mur est point d’arrêt et certitude. Le Taureau heurte le mur tête baissée et s’y installe. C’est ce que Dostoïevski appelle l’aplatissement sincère. « Le mur agit sur eux comme un calmant, une libération morale, comme quelque chose de définitif, quelque chose même, je peux dire, de mystique... ». Voilà que l’on rencontre le mur par ses effets : l’aplatissement ou le rebroussement. La mystique ou l’hystérie.
Sans le savoir, à plat contre le mur, nous avons rencontré l’homme normal. Le Taureau est cet homme normal. Normal ? C’est-à-dire : l’homme de la nature et de la vérité. L’Insecte, quant à lui, est le non-normal. Il est l’antithèse de l’homme normal. En tant que tel il sera tour à tour : l’idiot, le stupide, l’abruti. L’Insecte, en tant qu’idiot, est l’homme de la conscience accrue. Donc l’homme anormal, malade. Car « la conscience est une maladie ». Quant l’Insecte se rapporte au Taureau, qu’il le jalouse et l’envie, on l’appelle la Souris. La Souris aussi connaît l’aplatissement. Mais contrairement à l’aplatissement du Taureau contre le mur, l’aplatissement de la Souris se fait face au Taureau. C’est même par là que l’Insecte devient Souris. Que veut donc la Souris ? Se venger. Se venger de l’humiliation que lui fait subir l’assurance du Taureau. Se venger de l’existence du mur. Conséquemment, l’affect essentiel de la Souris, c’est la rage. La rage perpétuelle. Un autre dirait : le ressentiment.
Le Taureau vit au pied du mur. Où vit la Souris ? La Souris, elle, habite le sous-sol, loin, bien loin du mur. Le sous-sol ? Quelle différence avec le mur ? Si le mur est assurance plate, le sous-sol est le lieu où l’on ressasse et où l’on doute. Le sous-sol est l’espace de la rumination. Pourquoi ? Comme on l’a déjà dit : si la Souris ressasse et doute, c’est qu’elle est l’homme de la conscience accrue. Ce qui signifie selon Dostoïevski, non la lucidité, mais l’idiotie congénitale et la saleté originelle. Idiotie et saleté ? L’idiotie : ce par quoi l’individu se singularise, se refuse à toute généralité. Comme lorsque l’on parle d’un idiome, d’un idiolecte, d’une idiosyncrasie. La saleté : l’impur, l’équivoque, l’oscillation incertaine, surtout. La conscience accrue, c’est donc l’idiotie crasse. La singularisation non par la détermination mais par l’absence de fondement. Pas de fondement, pas de sol : sous-sol. La conscience accrue est vouée à l’inhumation volontaire, au sous-sol. Elle n’est qu’une valse-hésitation. Kafka dirait : un atermoiement illimité. Elle n’est jamais pure, jamais fondée. « À une seule question, elle a ajouté tant d’autres questions sans réponse que c’est à son corps défendant qu’elle a vu s’amasser autour d’elle une sorte de fange mortifère, un genre de boue malodorante que viennent composer ses doutes, ses inquiétudes et, pour finir, les crachats que lui envoient les hommes d’action spontanés qui, l’entourant gravement comme ses tyrans ou ses juges, la couvrent, riant à gorge déployée, de ridicule. » On voit que la Souris se moque bien de donner une forme à sa vie.
Nous avons donc le sous-sol où l’Insecte devenu Souris a fuit le mur. Le mur qui est la thèse dont le sous-sol est l’antithèse. Le mur, contrairement au sous-sol, est donc le positif. Nous demandions ce qu’est le mur. On peut maintenant en élucider la nature : le positif. Or le positif, au XIX° siècle, ce sont les lois de la nature, l’arithmétique, les logarithmes, les mathématiques et les sciences naturelles. Dostoïevski rassemble tout cela en un terme. Le positif, ici, c’est « l’impossible ». Le définitif. « L’impossibilité, c’est donc un mur de pierre ? » Voilà ce qui confère au Taureau les nerfs solides : quand il rencontre un impossible, « il se soumet illico ». Sa devise assurée : deux fois deux font quatre. D’où la bile de la Souris à entendre ce beuglement. Car celle-ci, on l’a dit, rebrousse face au mur, ne sait pas se soumettre et a les nerfs fragiles. « Bien sûr, ce n’est pas le mur que je trouerai avec mon front, si, réellement, je n’ai pas assez de force pour le trouer, mais le seul fait qu’il soit un mur de pierre et que je sois trop faible n’est pas une raison pour que je me soumette. »
Le Taureau est du côté de l’essence de l’action. La Souris est du côté de l’essence de la pensée. Cette essence, c’est : ne pas trouver de cause première. Ne pas trouver de cause première pour justifier l’agir. Toujours trouver une autre cause derrière les prétentions aux primautés. « Toute cause première en fait immédiatement surgir une autre, plus première encore, et ainsi de suite à l’infini. Telle est l’essence de toute conscience et de toute pensée. » Donnons un exemple. Le Taureau, s’il se venge, il se venge en toute justice. Sa vengeance a pour principe sa justification. Il a trouvé son mur. Sa cause première. La Justice. Il est vraiment l’homme de la nature et de la vérité. La Souris, l’être du sous-sol, si elle se venge, c’est sans vertu. Sans valeur. Elle dit : ma vengeance est juste. Puis, immédiatement après, ma vengeance est peut-être injuste, non-juste. Or se venger sans justice, c’est se venger sans cause première. L’absence de cause première dans la vengeance, Dostoïevski l’appelle : méchanceté. La méchanceté, un mouvement sans cause. Mais l’absence de cause, la méchanceté, n’est-elle pas aussi une cause ? Voilà ce que la Souris se demande, poursuivant la voie du doute. Ne serait-ce pas une… une causalité sans cause ? Une causalité du manque de cause ? Alors la Souris, qui réalise l’essence de la pensée, nous l’avons dit, se venge quand même mais elle le fait comme ne se vengeant pas. En somme, elle en souffre, elle culpabilise. Parce que la causalité première de l’absence de cause est tout aussi bien le prétexte à ne pas se venger. Le résultat c’est, en toute chose, la médiocrité et l’inertie du « glacial espoir-désespoir ». « Elle commencera peut-être à se venger, mais ce sera par à-coups, par des vétilles, comme dans le dos, incognito, sans croire ni à son droit de se venger ni au succès de sa vengeance et sachant par avance que toutes ces tentatives la feront souffrir elle-même cent fois plus que celui qu’elle vise – que celui-là, peut-être, elles lui feront l’effet d’une piqûre de moustique. »
Mais que vaut alors sa parole, à la Souris qui ne s’engage qu’en ne s’engageant pas ? Qu’est-ce que l’intelligence, si elle ne se fixe pas. La Souris fait apparaître que toute intelligence accrue est bavardage : « la fonction unique et évidente de tout homme intelligent reste le bavardage ». Le bavardage, la pensée qui s’infonde au sous-sol de ses doutes. La pensée de l’animal hystérique. Conception hypocondriaque de l’intellect.
Notre époque est une époque toute négative, dit Dostoïevski. Non que les Taureaux s’en aperçoivent. Elle l’est de son incomplétude. Le sous-sol est le principe d’incomplétude du mur. L’époque est négative parce que quelque chose ne s’aplatit pas. Qu’est-ce qui insiste ainsi en son relief ? Pour le savoir, revenons sur la théorie de l’aplatissement sincère. Le mur, du point de vue de l’action, devient table. Tablette. Le Taureau s’aplatit sur la table. En tant que table, le mur systématise tous les intérêts humains déterminés par la science. C’est-à-dire tous les contenus souhaitables de la volonté. On pourrait dire : le mur est la table du bien. En ce sens, le mur énumère tous les intérêts humains. Tous ? Dostoïevski ou son personnage-souterrain le nient. Il existe un intérêt « primordial » que le mur néglige. Mais contrairement à tous les autres intérêts énumérés sur la table, cet intérêt-là se refuse aux listes et aux classifications. « Cet intérêt-là est d’autant plus remarquable qu’il détruit toutes nos classifications et qu’il démolit constamment tous les systèmes imaginés par les amis du genre humain pour le bonheur du genre humain », « bref, il dérange tout le monde... » Qu’est-ce qu’un tel intérêt ? Pour le savoir, il faut d’abord comprendre ce que la « fausse logique » du mur nous promet. Les énumérations du mur, la liste des intérêts inclus sur la table, nous promettent une construction prochaine. Cette construction, nous l’appellerons le palais de cristal. Contre le mur s’appuie la promesse d’un palais de cristal. Quel est-il ? Il est la résultante d’une tendance erronée de l’esprit. Des falsifications volontaires. Cette tendance, c’est la tendance à « déformer la vérité » pour justifier un système, justifier sa logique. « La logique veut que ça paraisse vrai. » Exemple : l’idée que l’homme s’adoucit avec la civilisation. Civilisation comprise comme réalisation du système bien compris des intérêts humains. En vérité, la civilisation est aussi sanglante que la barbarie. La civilisation n’adoucit rien, elle complexifie les sensations. Bien. Donc, le palais de cristal dérive d’une fausse logique de justification du mur. Maintenant nous pouvons dire ce qu’est le palais de cristal : le dictionnaire rationnel et encyclopédique de toutes les actions humaines soumises aux lois nécessaires de la nature, un peu comme sur « des tables de logarithmes », « où tout sera noté et codifié avec une telle exactitude qu’il n’y aura plus jamais d’actes ni d’aventures. » Le palais de cristal est la cité de la vie calculée et inscrite au calendrier ou à l’almanach. C’est-à-dire la ville préméditée par excellence. Dans le palais de cristal, la vie sera mortellement ennuyeuse, mais « parfaitement rationnelle ». Est-ce fatal ? Nous en revenons alors à l’intérêt oublié par le mur, tâche noire sur la transparence du palais. Dostoïevski ne le nomme pas de manière univoque : cet intérêt, ce mystérieux intérêt, c’est la « liberté stupide », « la volonté particulière », « le caprice » ou encore « l’ingratitude ». C’est la volonté pure, la volonté indépendante. Nous pourrions dire : la volonté de vouloir. Ce à propos de quoi, au palais, les fonctionnaires ne veulent rien entendre.
En quoi les habitants du palais de cristal n’ont-ils pas la volonté de vouloir ? Le palais de cristal est un instrument de musique. Plus précisément, c’est un orgue. Le mur, sa liste, devient la partition dont les Taureaux aplatis sont les touches. Les habitants du palais sont des « goupilles d’orgue ». Pourquoi ? Parce que s’il s’avérait qu’un système de tous les intérêts les meilleurs de l’humanité pouvait se présenter comme système de toutes les fins désirables, alors la volonté, en prenant pour objets ces contenus nécessaires de la nature, disparaîtrait. Veut-on encore dès lors que l’on veut ce qu’il faut ? Non. On agit mécaniquement selon des lois. Le terme volonté devient non-sens. La pierre veut-elle le cours de son mouvement parabolique ? « Si l’on trouve une formule pour toutes nos volontés… l’homme cessera tout de suite de vouloir ». « Qui donc pourrait vouloir vouloir selon une formule ? ». À faire nos volontés selon la table, selon le mur, c’est-à-dire rationnellement, nous arrêterons de vouloir. Car dans le palais de cristal on ne peut pas vraiment vouloir ce qui n’est pas vrai. Quelle signification aurait-ce de vouloir l’absurde, le mauvais, le faux ? Souvenons-nous : on ne saurait vouloir le mal, les méchants ne savent pas ce qu’ils font.
Heureusement pour la Souris, pour les habitants du sous-sol, la volonté sature la raison. En tant que telle, elle sature et saturera toujours les palais de cristal. Cela tient à une double définition : celle de la volonté et celle de la nature humaine en général. La volonté n’est pas une disciple de la raison. Elle est « la traduction même de la vie toute entière », dont la raison n’est qu’une infime parcelle. De cela, il faut en déduire que l’homme en général, c’est la vie de l’homme, et sa vie, l’amplitude du vouloir. Or cette volonté, nous la disions indépendante, capricieuse, stupide. Voilà que la Souris la désigne et l’élève au rang de « stupidité suprême ». Et le ressort de la stupidité labile et volatile c’est, nécessairement, puisqu’il s’agit de ne pas donner de contenu extérieur à sa volonté, l’ingratitude phénoménale de l’être humain. « Je pense même que la meilleure définition de l’homme est la suivante : créature bipède et ingrate. » Monstrueusement ingrate. Pourquoi l’ingratitude est-elle la substance de la stupidité ? Parce que seul l’ingrat a une volonté vraiment libre, qui ne s’attache pas même… aux bienfaits. Impasse infinie que Dostoïevski définit comme une « jouissance bizarre », ce genre de jouissance que l’on aurait à savourer une rage de dent.
On voit là que « vivre », ce n’est pas bien vivre. Vivre, c’est satisfaire toute son « aptitude à vivre », qu’il ne faudrait pas confondre avec une aptitude à adoucir et élever sa vie, par la philosophie, par la raison. La jouissance bizarre, qui refuse la jouissance saine et rationnelle, est l’envers de toute thérapeutique. Écoutons cet être du sous-sol qui, subrepticement, nous introduit à Nietzsche (qui a vingt ans quand Les carnets sont publiés en 1864) : « la raison est, messieurs, une excellente chose – je vous l’accorde volontiers - , mais la raison n’est rien que la raison, elle ne satisfait donc que les besoins rationnels de l’homme, alors que le vouloir est la traduction même de la vie toute entière, oui, je veux dire de toute la vie humaine, la raison y comprise, et les grattages de méninges. Et même si notre vie n’apparaît souvent pas très propre sous cet éclairage, elle est quand même la vie, et pas seulement une extraction de racine carrée. Moi, par exemple, je veux vivre, de façon absolument naturelle, pour satisfaire toute mon aptitude à vivre et non pour satisfaire seulement toutes mes aptitudes rationnelles, c’est-à-dire juste un vingtième, et encore, de toute mon aptitude à vivre. »
Nous savons maintenant ce qu’est l’homme, du point de vue de la Souris. Une créature douée de qualités « bizarres », d’une « jouissance bizarre », celle de l’ingratitude qui exprime sa volonté, et donc, sa vie. Cette qualité, la Souris la caractérise comme « l’élément fantastique et fatal » de l’homme, auquel se mêle la raison. C’est par cet élément fantastique que se définit, secondairement, l’activité humaine : « toute l’activité humaine, vraiment, ne consiste qu’en cela que l’homme se prouve à chaque instant qu’il est un homme et pas une goupille d’orgue ! », « se convaincre vraiment qu’il est un homme et pas une touche de piano ! ». Mais, cette preuve, la Souris ne la doit qu’à son sous-sol. Elle la doit donc à l’instable, à l’incertitude, à l’inquiétude, à l’absence de sol. Cette preuve, elle la doit à son refus de la forme de vie.
Ce n’est pas fini. Nous pourrions nous arrêter là. Mais le meilleur est à la fin. Il serait si simple d’opposer le sous-sol au palais de cristal. De décréter : il est des hommes de boues qui luttent contre les hommes de verre. De croire que la Souris et le Taureau se battent pour l’éternité. De penser qu’on échappe au palais de cristal, comme les Taureaux pensent échapper au sous-sol. Eh bien non. Il y a une proto-dialectique qui anime tant la Souris que le Taureau : la dialectique du bâtisseur et du destructeur, la dialectique de l’ordre et du chaos. La Souris est nécessairement l’expression de cette dialectique.
D’un côté, nous voulons bâtir une œuvre qui dure. De l’autre, nous refusons l’impérissable, l’indolore, l’indestructible. En somme, l’intrahissable. D’un côté, nous aspirons aux villes préméditées. De l’autre, nous n’aimons que les spontanées. La Souris en apparence ne fait que crier : « vive le sous-sol ! » et rejette le cristal inaltérable au motif qu’on ne peut « même pas en douce lui tirer la langue ». Mais, en réalité, le palais demeure et gît sous la densité du désir. Il existe, non seulement comme accomplissement positif des lois de la nature et de la science (souvenons-nous de la table, de la liste, des intérêts), mais aussi, en même temps, comme forme du désir. Italo Calvino n’est pas loin qui voyait ses villes imaginaires prendre elles aussi, la forme du désir. Le palais existe « tant que mes désirs existent » dit la Souris. Et tant qu’ils existent, on ne lui fera pas prendre un poulailler pour Versailles. Par conséquent, alors qu’elle abhorre l’indestructible auquel dire « merde » est impossible, ce qui déçoit et anime pourtant la Souris, c’est que dans toutes les constructions des Taureaux « on en trouve pas, des palais où l’on ne puisse même pas tirer la langue. »
Comment résoudre cette configuration du désir, faite d’ingratitudes labiles et d’éternités minérales ? En distinguant bâtir et s’installer. « L’homme est un animal essentiellement bâtisseur, condamné à tendre vers son but en toute conscience par la voie de l’ingénierie, c’est-à-dire à se frayer un chemin, à tout jamais et sans interruption, vers où que ce soit. » En ce sens, même l’être des souterrains ressent l’impérieux désir d’un palais, « tant qu’à faire de vivre, autant vivre à Versailles ». Cependant, le palais n’est en vérité qu’une destination future quelconque, un vers où. Bien sûr, nous aimerions que le ciel se dégage, que le palais descende du ciel. Mais nous n’aimons ce palais que comme tendance, comme orientation quelconque, comme ce qui est vaguement le plus sublime. Le palais de cristal on l’aime « seulement de loin ». On désire le bâtir, mais non y vivre. On préfère « le laisser après soi aux animaux domestiques, du genre des fourmis, des moutons, etc. ». La Souris désire la fourmilière, mais plaint la fourmi. Elle ne construit jamais que ce qu’elle abandonne. Et son dernier mot devient : s’installer, est la fin du désir.
Ut talpa in deserto.
Appendice contemporaine - « Dostoïveski : une critique des formes-de-vie » :
La Souris nous invite à critiquer la conception contemporaine et récente du sujet sain. L’affirmation répétée et dominante selon laquelle le sujet serait « narratif », qu’il devrait, pour vivre, se conférer, s’attribuer « une forme » ou « un style ». Norme hégémonique de l’homo narrans. L’homme qui se la raconte. Qui se dandine ou se dandyne. Notre Souris réfute, par son existence et ce qu’il y a de touchant en elle, la conception narrative du soi. Conception dont nous pourrions avancer, avec sarcasme et mauvaise foi, qu’elle fonde son succès, au fond, sur la vieille poétique aristotélicienne et… sur la méthode scolaire de la dissertation. (Mais aussi sur l’exigence du curriculum vitae). Dans cette universalisation normative de l’homo narrans, de l’homme qui se la raconte, se raconte et raconte, on trouve, comme chez Aristote, comme dans n’importe quel C.V. et comme dans la méthode de la dissertation, le fantasme de la cohérence, de la diégèse, et plus généralement, de la détermination des événements, des accidents et des faits par la « Forme ». Tout accident et tout heurt devient une « péripétie ». Tout fait doit pouvoir s’agencer en fonction de l’unité signifiante. Unité de lieu et de temps. Projet. Mais puisqu’une telle unité doit parfois se faire hors-sol, elle devient aussi l’unité d’un style. Or ce qui structure une forme ou un style, ce qui la distingue d’une autre forme ou d’un autre style, c’est la problématique interne à laquelle l’une et l’autre se rapportent. Et cette problématique, c’est-à-dire cette manière particulière de concevoir et de poser les problèmes de sa vie, se rapporte elle-même à un petit nombre de valeurs directrices, d’axiomes ou de postulats de la pratique qui en deviennent les limites, les bornes ou les rives. Ce que la Souris nous apprend, c’est justement à questionner frénétiquement ces axiomes, ces rives. Elle se permet tout un tas de restes inutiles, de gestes ratés, vains, de drôles de tâtonnements ridicules, d’errance, et elle travaille à perdre activement la face, la raison, le fond. Ce qui nous touche, c’est qu’elle a tort, plutôt que raison. C’est qu’elle ne vit pas d’autojustifications. Sa médiocrité est souvent moins médiocre que l’effort par lequel le Taureau paraît noble à s’aplatir contre les murs du « c’est comme ça »
Gérard Genette écrit que « la dissertation ne connaît pas de contenu qui ne soit pas déjà saisi, orienté, infléchi par une forme, c’est-à-dire par un ordre. » Et il cite Chassang et Senninger écrivant « la dissertation est comme un univers où rien n’est libre, un univers asservi, un monde d’où tout ce qui ne sert pas à la discussion d’un problème fondamental doit être exclu, où le développement autonome est la plus grave faute que l’on puisse imaginer. » À lire ce texte à la suite de la définition de la vie des Taureaux sous le régime du Palais de Cristal, à la comparer aux exigences qui configurent une conception de la vie en terme de « forme-de-vie » (je parle de son sens métaphysique et politique, pas de son sens ordinaire, équivoque, général), on ne peut s’empêcher d’y voir des analogies structurelles. La forme-de-vie, la diégèse aristotélicienne, la dissertation (et bien entendu, le C.V.) ne sont peut-être qu’une seule et même chose. Peut-être.
Mais qui désire se vivre soi-même comme une dissertation de terminale ?







