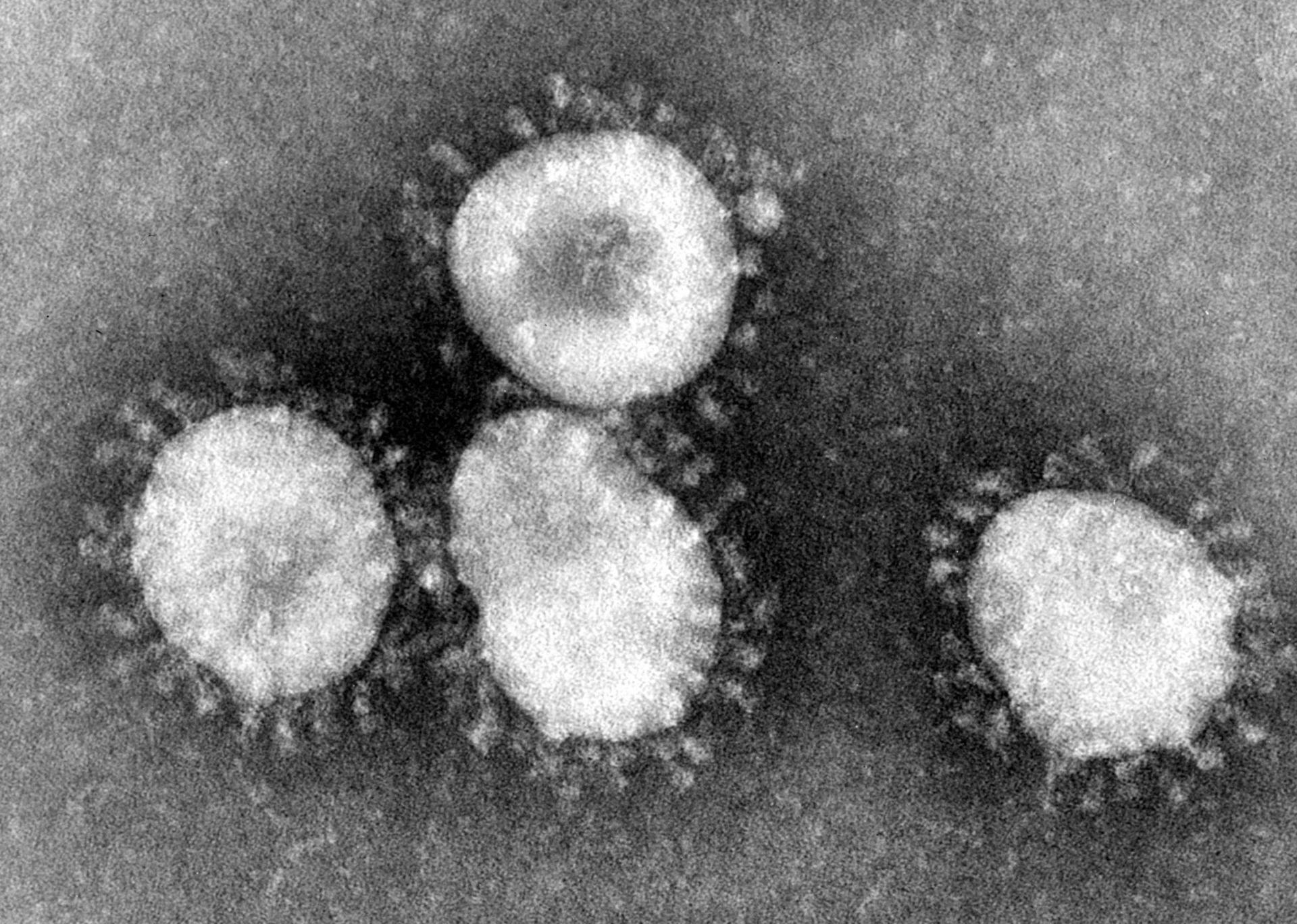-
FILMER LA REVOLTE – LOW LIFE
- Lundi Matin : Dans votre film Low Life, on a parfois l’impression d’une certaine impuissance politique. Les personnages, les militants sont dans une forme d’errance, une forme de demi-sommeil presque, ils ne sont pas habités par des passions très vives...
- LM : C’est une léthargie que vous ressentez dans la vie quotidienne en France, ou en Europe ?
- LM : Mais il reste toujours, dans vos films, une possibilité de résistance ...
- LM : Je vais poser la question que j’ai posée aux autres personnes interviewées... C’est une question de politique-fiction : si les élections n’ont pas lieu, qu’est-ce que ça change pour vous ?

- Nicolas. Klotz : Au contraire, ils protègent leurs passions. Sans cela, ils brûleraient. Comme tant de gens aujourd’hui. Dans l’étouffement collectif que nous vivons depuis 15 ans, il faut protéger les passions. C’est vital, sinon on perd notre humanité. Je n’ai pas peur de ce mot, humanité. Notre seule véritable arme capable d’en finir avec le cynisme dépressif qui éteint tous les élans, tous les soulèvements, tous les désirs de révolte. Elisabeth et moi ne faisons pas des films pour juger. On n’a pas fait Low Life pour dire que la jeunesse serait léthargique. Mais pour affirmer haut et fort qu’elle est toujours, depuis toujours, absolument contemporaine ; et que c’est là où se trouve sa puissance, son secret magnifique, sa vitalité créatrice. Nous voulions filmer une force de mort, un envoûtement collectif contre lequel nos personnages tentent de se battre corps et âme ; avec leurs désirs, leurs lectures, leurs musiques, leurs rituels de combat et leurs solitudes. La narcolepsie qui envahi Julio, le jeune mineur africain arrêté par la police dans le métro, est une maladie très répandue parmi les enfants de réfugiés. Une avocate lyonnaise que nous avons rencontré pendant l’écriture du scénario nous racontait comment cette maladie a fait apparition chez les enfants et les adolescents sans-papiers. Déjà il y a 6 ans. A cause de la peur. Une peur virale qui contamine. Hussain et Carmen se réfugient dans leurs chambre et entrent dans cet état singulier, qu’ils appellent Low Life. Qui est une espèce de métaphore, une zone de conjuration, une région à l’intérieur d’eux-mêmes, où règne l’égalité des dormeurs, le sommeil vif des amants… Pour puiser des forces afin d’affronter l’envoûtement contre lequel le film travaille. Mais pour pouvoir conjurer cet envoûtement, il faut d’abord le percevoir, en filmer les contours, sa densité, son pouvoir. C’est une lutte à mort pour la vie.
- Elisabeth Perceval : Les dix premières minutes de Low Life ; des sms résonnent sur les portables, des groupes de jeunes s’organisent à travers la ville, et vont aller s’interposer aux forces de police, venues faire une descente dans un squat. Il ne s’agit pas de militants, au sens où ils appartiendraient à un parti politique, mais plutôt des jeunes organisés en réseaux tels que RESF, les Indignés, Nuit Debout… Les personnages de Low Life sont là, Camille, Djamel, Julie, Georges… face aux flics, engagés dans l’action. Je dirais alors que l’état d’errance et de demi-sommeil dont tu parles, est celui de la politique elle-même, des dirigeants des partis de gauche comme de droite, mis sous perfusion depuis belle lurette. Les jeunes de Low Life sont portés par le soulèvement ; celui de leurs désirs amoureux, des utopies et des espoirs partagés. Comme dit Franz Fanon : Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge.
- N. Klotz : Au Brésil, un jeune critique a comparé Low Life à L’Armée des Ombres de Melville. Il parlait d’un film sous occupation, dans une guerre contemporaine. Une guerre qui n’est visible que par ceux qui sont pris dedans. Comme Carmen, une fois entrée dans la guerre de Hussain, elle la voit partout. Sa vision du monde et sa manière de vivre se déplacent, se transforment, comme pendant les guerres. Il faut arriver à nommer collectivement cette guerre contemporaine qui s’infiltre dans les rapports humains. Comment sinon la combattre ? Filmer cette guerre-là pose des questions de cinéma passionnantes, notamment celles du cinéma fantastique. Car c’est une guerre qui vient de très loin, elle a plusieurs siècles, elle a traversé la colonisation, les horreurs du siècle passé, et aujourd’hui, le capitalisme médiatique.
- N. Klotz : Léthargies, fuites, cloisonnements, murs ; les histoires d’amour se cassent la gueule très vite aujourd’hui. On a beaucoup de jeunes amis dont les histoires d’amour se brisent sans arrêt, rien ne semble possible. Ils nous disent : "ce qui semblait génial, à votre époque, c’est que vous aviez des vrais combats à mener. Nous, contre quoi on va se battre ?" Or malgré tout ce qu’en disent ceux qui s’enrichissent de la destruction des sentiments ; la planète a déjà commencé à exploser. Des combats il y en a. Il n’y a que ça d’ailleurs. Des combats à mener. Tous les jours. Néanmoins, quelque chose nous vide de notre énergie, à force de ne pas faire les choses. Et de voir dans nos renoncements une fatalité quasi cosmique. Le système est très fort pour ça, faire circuler toutes sortes d’algorithmes virales qui produisent une capacité d’envoûtement grandissante pour imposer leurs modèles. Nous en sommes à ce point qu’un psychotique obsessionnel comme Trump est aujourd’hui le Président des États-Unis et qu’il pourrait, avec quelques autres, en à peine quelques mois, décider de mettre le monde à feu et à sang. Est-ce que l’Histoire a toujours été comme ça ? Et qu’on ne s’en serait pas rendu compte à cause de la disparition des témoins et d’une croyance aveugle dans le « progrès » qui date des années 50 ? Un temps linéaire qui irait du pire vers le meilleur ? Est-ce qu’elle a toujours été aussi dégueulasse ? Comment a-t-on pu perdre à ce point confiance en nos capacités de soulever les choses ? Dans le cinéma comme un peu partout, l’institution et les pouvoirs dominants ont repris le pouvoir aux innovateurs. Comment reprendre aux institutions tous ceux qu’elle nous a volés ? Les intellectuels comme les cinéastes. Comment retrouver nos amis qui sont passés de l’autre côté ? Comment mettre à nouveau nos forces créatrices en commun ?
- E. Perceval : Bien sûr, depuis le début de notre travail, résister fait partie de la jubilation qu’on a à faire les films qu’on fait. Résister est cette sensation de chaleur qui circule dans nos nerfs, de l’ordre de la jouissance, de la force créative, qui nous pousse vers l’inconnu, les choses à découvrir. Emmener la caméra dans des zones de la société où le cinéma ne s’est pas encore aventuré. Paria, par exemple. Un film de fiction avec des gens qui vivent dans la rue. Parce que ce qui se passe-là a à voir avec nos histoires, nos sensibilités. Et qu’on a choisi de parler d’un monde plutôt qu’un autre. Des gens qui n’ont rien. Resistance, ce mot est partout dans le film, dans leur corps, dans leur regards, leur joie, leur humour, dans leur appétit sexuel. Notre film dans la Jungle de Calais est porté par la même urgence.
- N. Klotz : Résister, c’est ce qu’on fait tous. Chacun à sa manière. Plus on se met en mouvement, plus on fait circuler les choses. Plus ça produit des effets dans le réel. Des effets en chaîne qui intensifient les luttes qui se développent là où elles doivent aller. Pas nécessairement tous ensemble parce que ça ne marche jamais vraiment, la concordance des luttes. Mais rester connectés afin de décrire ce qui se passe. En fait, c’est la question : qu’est-ce qui se passe ? Nos regards, nos vies, sont tellement étouffées par l’information - par sa production instantanée, son économie, ses multiples mutations - que cet étouffement empêche de voir le réel. Cet étouffement est devenu notre réel.
- E. Perceval : Depuis une quinzaine d’années il y a tellement eu de renoncements, de capitulations, de trahisons… On a vu petit-à-petit l’indifférence s’installer, devenir, avec le cynisme, la position chic d’une grande partie des intellectuels de gauche. On s’est trouvé comme pris de court, par la vitesse du basculement à droite de cette gauche. Les idées réactionnaires, les comportements, les clans des « entre-soi » naturellement dominants, étaient déjà en place, installés partout, dans les institutions, les commissions, les exploitants de salle… Et on se l’est pris en pleine tête à la sortie de Low Life. Après les coups, qui font mal, on a choisi le repli, pour continuer à faire notre métier. Continuer à faire les films qu’on voulait. Avec la jubilation de découvrir et d’approfondir notre recherche.
- N. Klotz : La technologie numérique à libéré les auteurs. Elle a permis aux cinéastes de reprendre en main leur outil de travail. C’est une véritable révolution. Technique, esthétique, économique et politique. A partir du moment où les cinéastes peuvent se réapproprier leur outil de travail - caméra, carte mémoire, enregistreur, disque dur, logiciel de montage, projection… - à partir de ce moment-là, on peut tout réinventer et faire des films avec énormément d’ambition esthétique et narrative, malgré le manque d’argent. Il ne faut jamais lâcher sur ça. Travailler tous les jours, quelque soit le système de financement ou de non-financement dans lequel on travaille. Ce qu’on appelle l’actualité cinématographique a perdu son actualité et repose sur l’idée totalement dépassée qu’il y aurait chaque semaine une quinzaine de nouveaux films urgents à voir. Chef d’oeuvre ! Emouvant ! Hyper Sublime ! Hypra Bouleversant ! On sait bien que c’est faux. Ce qui se passe de neuf aujourd’hui dans le cinéma a lieu ailleurs, loin des salles commerciales.
FAIRE UN FILM A CALAIS – NAISSANCE D’UNE VILLE

- N. Klotz : Par où commencer ? Nous sommes en plein montage et avons encore un tournage à faire. On aimerait bien discuter du film mais nous sommes encore trop dedans. Une chose est certaine, c’est un film épique, une épopée, qui racontera la naissance et la destruction d’une ville surgie de la boue. La Jungle. Un film qui travaille sur la couleur, avec la couleur, les couleurs très particulières qu’on y a vues. Comment filmer la couleur ? C’est autant une question esthétique que politique. Ces couleurs que les réfugiés génèrent autour d’eux. Leurs couleurs mutantes, clandestines, pleines d’histoire(s), de savoirs, de puissances de vie, d’espoirs et de désespoirs, de secrets. Beaucoup d’entre eux sont vraiment très jeunes. Entre 17 et 25 ans, parfois un peu plus. C’est un film très important pour nous, né de nos rencontres avec une vingtaine de réfugiés, au moins autant de langues, et cette lande héroïque que nous avons arpenté pendant plusieurs mois, coincée entre la voie rapide et la Manche. Une suite documentaire de La Blessure que nous avions réalisé en 2003. Je dis documentaire mais c’est autre chose. Le cinéma est en pleine mutation.
- E. Perceval : Dans ce film, nous ne faisons pas de discours sur les gens de la Jungle ou sur la politique... On est là pour faire notre travail de cinéastes. On ne va pas perdre notre temps à parler de Hollande, Valls et Cazeneuve. Ils ont pris la décision de détruire la Jungle. Comment vont-ils s’y prendre ? Comment vont-ils faire pour expulser 10 000 personnes ? Qu’est-ce que ça raconte aujourd’hui ? Qu’est-ce que ça nous rappelle d’hier ? De quoi ça nous parle pour demain ?
- N. Klotz : Il est difficile d’imaginer comment ceux qui vivent tout cela depuis des années, vont faire lorsque un Etat démantèle à nouveau leur vie. Un Etat démocratique censé les protéger. Où vont-ils aller, quelles sont leurs angoisses, quelles techniques se développent, quels nouveaux espoirs, quelles possibilité de retournements ? Un jeune Erythréen que nous filmons depuis février dernier vient de nous raconter qu’il était possédé par le diable…
- E. Perceval : Ce garçon de 18 ans, très doux, est persuadé que le diable est en lui. Habite son corps et a volé son âme. Quand il se décrit, c’est lui qui devient le diable, et les mots du diable parlent à travers lui. On entend dans ces mots qu’il emploie comment les policiers parlent des réfugiés, de leur dangerosité, leur brutalité, qu’il sont des violeurs potentiels, des voleurs. Et de la peur qu’ils provoquent chez les gens de Calais et bien sûr, d’ailleurs.
- N. Klotz : Ils vivent sous le regard, les caméras, les cars et les hélicoptères de la police, tous les jours. Ils vivent dans leurs gazs et sous leurs matraques. Ils essayent 30, 40 fois, de partir en Angleterre, se font arrêter à chaque fois. Souvent par les chiens, d’ailleurs, parce que ce sont les chiens qui sentent leur odeur. Ils rusent avec les scanners, les détecteurs de battement de cœur, mais se font avoir par les chiens. Même quand il pleut. La frontière anglaise s’est déplacée à Calais. La frontière de l’Europe est devenu leur peau. Le jeune Erythréen, il commence à avoir des crises de panique, et ce sentiment qu’il est habité par le diable.
- E. Perceval : Il fait des crises tellement fortes que sa communauté fait appel régulièrement à un prêtre pour le calmer, par des prières, des douches froides, des régimes alimentaires…
- N. Klotz : Quand tu vois les effets concrets que provoque cet encerclement dans leurs corps et dans leurs imaginaires, c’est ahurissant. Il y a ceux qui ont la puissance, l’énergie de s’en foutre et de se dire : « j’y vais quoi qu’il arrive » et qui finissent par y arriver, et il y a ceux qui s’effondrent... Tout cela réveille trop de choses. A 18 ans, quand tu as été en prison en Libye, quand tu as fui l’Érythrée parce que tu refuses de devenir un militaire, un robot-tueur. Parce que rester en Érythrée, c’était accepter de devenir un robot, de tuer sans sentiment dès 14, 15 ans. Si tu ne fous pas le camp, ton cerveau est transformé en robot. Et si tu fous le camp, tu te retrouves en prison en Libye, affamé, entouré de jeunes gens qui meurent autour de toi. Tu es frappé, tu trouves 5000 dollars pour être libéré de l’enfer. Et tu arrives à Calais, à nouveau la police… C’est des histoires de possession. C’est Homère ! C’est des histoires de cette dimension-là. C’est l’Odyssée. Et devant une telle expression de la civilisation contemporaine, tous ces réfugiés ne trouvent aucun interlocuteur digne de ce nom au niveau de l’Etat. Juste des chiffres, des raisonnements de comptables, des communicants anesthésiants, des techniciens de l’administration et des calculs électoraux. La Jungle était une ville de l’avenir, une opportunité extraordinaire pour construire une ville prototype. Une ville-monde. Un Atlas du monde contemporain qui pouvait offrir une pause, un abri, une halte, à des dizaines de milliers de personnes en danger de mort. Qu’elle soit physique ou économique, la mort se propage partout si on ne l’arrête pas collectivement. Plutôt que de ramener Calais vers l’histoire des camps européens du siècle dernier, il aurait fallu la volonté de construire des villes-transit, avec eux, depuis le futur.
- E. Perceval : C’est comme si l’Occident était incapable de sortir de cette représentation du camp pour les personnes en situation d’errance ou de demande d’asile. Comme si cette représentation du camp de concentration était la seule possibilité pour nous de les recevoir. Alors que là, il s’agissait d’une ville qui s’inventait. Une sorte de communauté hybride. Avec son organisation en mouvement, sur lequel l’Etat n’a pas le contrôle et qui échappe à l’ordre établi.
- N. Klotz : Défaire l’ordre établi et construire d’autres modes de vie, c’était cela aussi Calais. Et ça marchait assez fort. C’était un lieu scandaleux.
- E. Perceval : Alors c’est vrai qu’il y avait des trafics de drogues, de la prostitution, mais comme dans n’importe quelle ville. Mais il y avait aussi des cafés pour se réunir, écouter de la musique, discuter, des restaurants à 3 euros le repas, des écoles pour apprendre le français, une salle de boxe, des boîtes de nuit… un centre juridique avec des avocats bénévoles pour défendre leurs droits.
- LM : Est-ce que vous avez essayé de leur donner une caméra, pour qu’ils produisent eux-mêmes leurs propres images ?
- N. Klotz : Ca, c’est le fantasme d’un certain type de militant. C’est difficile de filmer. En plus de tous les problèmes de survie auxquels ils doivent faire face, on devrait leur demander de faire des films ? Tout le monde ne veut pas être filmé, il y a des tas de gens qui détestent la vision d’une caméra, que ça rend même un peu violent. Et ça se comprend. En revanche, beaucoup écrivent leur histoires. Et ils écrivent très bien. On a proposé des caméras à plusieurs d’entre-eux, pour filmer leurs tentatives de fuite vers l’Angleterre. Aucun n’a accepté. Ils étaient trop occupés à organiser leur fuite. Et ne voulaient pas s’attirer de problèmes avec leurs camarades, ni avec la police.
- E. Perceval : L’idée de donner une caméra, c’est vraiment n’importe quoi. La paresse même. « Tiens, je te donne une caméra, fais-le ton film. » Ça va pas plus loin que ça. « Ça veut dire quoi je fais mon film ? Je m’invente une histoire ? Je filme mes copains ? T’as raison, j’ai que ça à faire !… » C’est infantilisant.
- N. Klotz : Il y avait une cinéaste qui était là et qui filmait avec son iPhone en disant : « moi je ne suis pas là pour la beauté de l’art. » On était trois-quatre à avoir entendu et ça a pris dix minutes avant que quelqu’un ose dire quelque chose. Mais qu’est-ce qu’elle raconte ? On n’est pas là pour la beauté de l’art ... « Je vais filmer avec mon iPhone 7 à 900 euros, faire des plans de merde, juste pour montrer qu’ils vivent dans des conditions de merde ? » Est-ce qu’il n’y a pas moyen d’aller un peu plus loin, de prendre le risque de filmer autre chose que la boue et la misère humaine qui sautent aux yeux ?
- E. Perceval : Ils n’auraient pas droit à de vrais plans ? On n’aurait pas de temps à passer avec eux tous les jours, à se rencontrer, à s’écouter, partager des repas ? Mais au moins on peut leur filer une vraie caméra et on se vante de la liberté qu’on leur donne !
- N. Klotz : Ce qui aurait vraiment été fort, c’est de leur proposer d’organiser une chaine de télévision dans la Jungle. Là, ça prendrait une autre dimension. Pas juste une camera ici ou là, mais d’inventer avec eux et une école de cinéma, avec Le Fresnoy par exemple, une structure sauvage de travail. Parmi les réfugiés iraniens que nous avions rencontré, il y avait des étudiants en cinéma et des calligraphes. L’un d’entre eux avait même travaillé avec Kiarostami.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES

- N. Klotz : La cinquième République est en phase terminale, elle est trop atteinte pour être sauvée, trop malade, trop usée. Si les élections n’avaient pas lieu, personnellement, ça serait un immense soulagement. Ce serait comme retirer les perfusions, débrancher la machine infernale, laisser mourir ce qui doit disparaître pour fonder une nouvelle République. Immense chantier collectif et défi historique. La sixième République, c’est plutôt inspirant non ? Bien plus que Marine Le Pen, François Fillon ou Emmanuel Macron qui trainent leurs vieilles idées momifiées.
- E. Perceval : Ça fait un certain temps qu’on se rend compte que ce geste de mettre un bulletin de vote dans l’urne n’est plus du tout un geste politique. On se demande ce qu’il en reste ; une habitude ? un tic nerveux ? C’est souvent la peur, alors on vote contre, comme en 2002, on a du se retaper Chirac. Il faudrait maintenant cesser d’avoir peur. Arrêter de faire semblant d’y croire. Il n’y a plus personne et plus rien n’est gouvernable. Tous sont remplaçables, remplacés - acteurs interchangeables. La mascarade est terminée et on piétine les masques ; et on découvre la laideur et nos regards vides. C’est un faux rendez-vous. Je ne m’y rends pas, à ce faux rendez-vous, parce que ça m’empêcherait d’avoir un vrai rendez-vous. Si personne ne va aux urnes, on ira tous chez Yvonne boire des coups et on fera la fête, la fête bordel ! La seule victoire qui vaille que vaille.
- N. Klotz : Débrancher la machine pour recommencer à danser sans perfusions car on danse pour être ensemble.