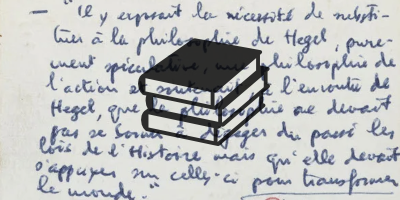10 mars 2006 Occupation de la Sorbonne

Comité d’Occupation de la Sorbonne en Exil. Communiqué n° 1
RECTIFICATIF
Quelques erreurs s’étant malencontreusement immiscées dans les comptes rendus médiatiques, le Comité d’occupation de la Sorbonne en exil (COSE) tient à faire les rectifications suivantes :
1. Il est bien vrai que nous avons projeté chaises, échelles et extincteurs sur les gendarmes mobiles qui fermaient à nos camarades l’accès de la Sorbonne. En revanche, aucun livre n’a été déplacé. Notre but était de faire reculer les flics afin de libérer l’entrée, et l’on voit mal ce que de tels Robocops pourraient craindre fût-ce d’un pavé de sociologie. On prétend que nous aurions abîmé quelques uniformes avec nos projectiles. Ceux qui matraquent et humilient nos frères et nos soeurs chaque jour dans tout le pays peuvent commencer à compter leurs blessés. Ils nous indiffèrent.
2. Reconnaissons-le. Certains d’entre-nous ont effectivement tenté de s’opposer à ces jets, qu’ils assimilaient à de la « violence ». Ce réflexe conditionné est à mettre sur le compte de l’éducation castratrice que nous recevons, de la pacification que nous subissons. Ces oppositions doivent aussi beaucoup à la confusion et au manque de discussions, qui auraient à coup sûr convaincu chacun de l’impérieuse nécessité de ce geste.
3. S’il avait manqué un seul argument pour en finir avec tout le bon sens citoyen des opposants en question, l’irruption par effraction des CRS dans la faculté, armés et non-détenteurs d’une carte d’étudiant de la Sorbonne,
ainsi que l’utilisation de haches pour fracturer des portes en bois massif l’a fourni. Par là, l’État a montré qu’il se place délibérément sur le terrain de la casse, terrain qu’il serait déraisonnable, pour nous, de déserter.
4. La Sorbonne est un bâtiment qui nous tient à coeur, pour sa vétusté autant que pour son caractère labyrinthique. C’est pourquoi les dégradations furent limitées au strict nécessaire (ouverture de portes, nettoyage du local de
l’UNI, etc.), c’est pourquoi aussi nous ne l’avons pas brûlée.
5. Durant l’occupation, le sénateur Mélenchon s’est introduit dans les bâtiments grâce à la complicité de quelques infiltrés de l’UNEF. Sa venue a spontanément déclenché son expulsion, devant la grossièreté d’une telle manoeuvre de récupération. Le fait qu’il soit entré avec l’aide de la police (et non, comme tout le monde, par l’échafaudage) dit assez l’ignominie du personnage.
6. Notre expulsion n’entame en rien notre détermination, bien au contraire. Nous reviendrons quand nous le déciderons.
Paris, le dimanche 12 mars 2006

Comité d’Occupation de la Sorbonne en Exil. Communiqué n°4.
MISE AU POINT
La Sorbonne, avec ses airs d’éternité. Enceinte d’histoire suspendue. Couloirs de marbre comme un étang gelé. « Faute de soleil, sache mûrir sous la glace ». Il y a dix jours, un dégel, une soirée contre les siècles. Un feu de tables, les tracts de l’UNI : flamme plus haute qu’un homme, au milieu de la cour, la cour d’honneur. Ça ne murmure plus dans les amphis, dans les couloirs, ça ne discourt plus, ça s’entrechoque, à la recherche d’une composition. Ça commence. Ça jette, des cris, des extincteurs, des chaises, des échelles, sur les flics. Un monstre se réveille.
Le pouvoir est stupide. Il fait du footing. Il a cru anéantir, en nous expulsant, le souffle qui a émergé là. Bêtise. Bêtise lourde comme une unité centrale sur le casque d’un CRS. En nous exilant, il n’a fait qu’étendre au monde notre terrain d’action. Grâce lui soit rendue de nous avoir pris notre Sorbonne, de nous en avoir dépossédés. En imposant sa police, il l’a offerte à tous les dépossédés. À l’heure où nous écrivons, la Sorbonne n’appartient plus aux sorbonnards, elle appartient à tous ceux qui, par la parole ou le cocktail, entendent la libérer. Depuis notre exil, donc, quelques pensées sur l’état du mouvement.
Mise au point n° 1 : Nous sommes en lutte contre une loi votée à la majorité par un parlement légitime. Notre seule existence prouve que le principe démocratique du vote à la majorité est contestable, que le mythe de l’assemblée générale souveraine peut être une usurpation. Il appartient à notre lutte de limiter autant que possible la tyrannie du vote majoritaire. Trop d’espace accordé aux assemblées générales nous paralyse, et ne sert qu’à conférer une légitimité de papier à quelques bureaucrates en herbe. Elles neutralisent toute initiative en instituant la séparation théâtrale entre les discours et les actes. Une fois votée la grève illimitée jusqu’au retrait de la loi sur l’égalité des chances, les assemblées générales doivent devenir un lieu de palabre, de mise en commun des pratiques, des idées, des désirs, un moment de notre constitution en force, non plus la scène de toutes les luttes de pouvoir, de toutes les intrigues pour emporter la décision.
Mise au point n° 2 : Les bureaucraties syndicales, bien qu’elles persistent dans leurs habituelles manipulations, ne sont pas un obstacle aussi sérieux au mouvement réel que les réflexes citoyens de pacification, diffus parmi nous. Durant la nuit de l’expulsion de la Sorbonne, une partie des étudiants ne savaient pas pourquoi ils étaient là ni ce qu’ils pouvaient faire, moins encore ce qu’ils devaient faire. Ils promenaient avec eux l’angoisse d’une liberté offerte mais impossible à saisir, faute de l’avoir désirée. Une semaine plus tard, au fil des occupations, des affrontements avec les forces de l’ordre, l’impuissance revendiquée laisse place au goût innocent de l’action directe. Le pacifisme retourne à ce qu’il n’aurait jamais du cesser d’être : une pathologie existentielle bénigne.
Mise au point n° 3 : La lutte appartient à ceux qui la font, pas à ceux qui voudraient la contrôler.


Mise au point n° 4 : Le mouvement permanent, celui de la circulation de tout, est la condition paradoxale du maintien en l’état de la machinerie capitaliste. Tout aussi paradoxalement, l’interruption de son fonctionnement est la condition de tout début de bouleversement. Par le blocage, nous luttons contre le blocage absolu de la situation.
Mise au point n° 5 : Nous nous référons 68, il est vrai, non à ce qui s’est effectivement passé en 68, à son folklore, à la Sorbonne occupée d’alors, aux barricades du Quartier latin, mais à ce qui ne s’est pas passé en 68, au bouleversement révolutionnaire qui n’a pas eu lieu. ON voudrait, en nous projetant dans le passé, nous extraire de la situation et nous faire perdre l’intelligence stratégique de celle-ci. En traitant 68 comme un simple mouvement étudiant, on voudrait éloigner la menace encore présente de ce que 68 a pourtant été, une grève sauvage générale, un éclat de grève humaine.
Mise au point n° 6 : L’idée de débattre démocratiquement, chaque jour, avec les non-grévistes, de la reconduction de la grève est une aberration. La grève n’a jamais été une pratique démocratique, mais une politique du fait accompli, une prise de possession immédiate, un rapport de force. Nul n’a jamais voté l’instauration du capitalisme. Ceux qui prennent parti contre la grève se placent pratiquement de l’autre côté d’une ligne de front, au travers de laquelle nous ne pouvons échanger que des invectives, des coups et des oeufs pourris. Face aux référendums mis en place pour casser la grève, il n’y a pas d’autre attitude à adopter que leur annulation par tous les moyens.

Mise au point n° 7 : Une étrange idée hante ce mouvement, celui d’une occupation des facultés aux heures ouvrables. D’une occupation qui ne serait pas libération de l’espace. Où vigiles, pompiers, administrations, prétextes d’autorité et de sécurité continueraient à exercer leur empire infantilisant, où l’université resterait platement l’université. Il est vrai que cet espace une fois conquis, nous devrions le peupler, le peupler d’autre chose que du désir de retourner à la normale. Nous placer dans la perspective sereine qu’il n’y aura pas de retour à la normale. Puis habiter cette irréversibilité.
Mise au point n° 8 : Les coordinations nationales reflètent la stérilité d’une certaine idée, classique, de la politique. Les syndicalistes et les groupuscules gauchistes (PT, LCR, LO, UNEF, SUD, FSE, Combat, CRI, Groupe bolchevique) proposent à des AG atones des plates-formes pré-rédigées par leurs directions. Dans une ambiance qui fleure bon le énième congrès du PCUS, la coordination nationale ne déroule qu’un jeu de pouvoir soviétique entre « orgas ». Nous opposons à cela l’idée d’une coordination parallèle prenant exemple sur le mouvement lycéen de l’année dernière, une coordination ouverte qui n’est qu’un lieu itinérant d’élaboration stratégique nationale.
Mise au point n° 9 : Nous sommes les héritiers de l’échec de tous les « mouvements sociaux » non seulement depuis trois ans (profs, retraites, intermittents, LMD, EDF, lycéens), mais depuis 1986 au moins. De ces échecs, nous avons tiré les leçons. Le premier d’entre eux porte sur les médias. En se
faisant écho du mouvement, les médias en deviennent de fait une composante qui, lorsqu’elle se retire (généralement au même moment que les bureaucraties syndicales) viennent provoquer son effondrement. La force d’un mouvement est sa puissance effective, non ce qui s’en dit, les ragots sur son compte. Le mouvement doit se garder par tous les moyens, fût-ce par la force, de l’emprise médiatique et élaborer une parole qui lui soit propre.
Mise au point n° 10 : Aucun des « mouvements sociaux » des dernières années n’a obtenu en des mois de « lutte » ce que les insurgés de novembre ont discrètement obtenu en trois semaines d’émeute - suspension de toutes les radiations des aides sociales dans les quartiers concernés, rétablissement du financement aux associations les plus absurdes. Et ce sans rien demander. Revendiquer, c’est formuler son existence dans les termes mutilants du pouvoir, c’est concéder à l’adversaire l’avantage du terrain.
Même du point de vue de qui veut obtenir quelque chose c’est con.
Mise au point n° 11 : Finis les défilés, les journées d’action décrétées par les centrales. Des occupations et des manifestations sauvages ! L’assemblée des grévistes de Rennes préfère déjà les manifestations « à parcours intuitif », refuse de subir les parcours de la préfecture et la présence de ses sbires. Le service d’ordre a même changé de fonction, comme de nom : il s’appelle « service action » et s’organise pour l’affrontement avec les forces de l’ordre.
Mise au point n° 12 : Qu’on ne nous dise plus que ce que nous faisons est « illégitime ». Nous n’avons pas à nous envisager du point de vue des spectateurs de la lutte, ni à fortiori du point de vue de l’adversaire. La légitimité appartient à qui pense ses gestes. A qui sait ce qu’il fait, et pourquoi il le fait,. Cette idée de la légitimité est évidemment hétérogène à celle d’État, de majorité, de représentation. Elle n’obéit pas au même type de rationalité, elle pose sa propre rationalité. Si le politique consiste en la guerre entre différentes légitimités, entre différentes idées du bonheur, notre tâche est désormais de nous donner les moyens de cette lutte. Sans autre limite que ce qui nous paraîtra juste, et joyeux.
Paris, le lundi 20 mars 2006
ULTIME COMMUNIQUÉ
Les étudiants ont repris leurs études. Les facultés ont rouvert leurs portes et les professeurs leur claque-merde. Le cycle planétaire de la vie micro-dosée se terminera, comme prévu - comme toujours - en juin : les examens auront lieu puis on ira mériter ses vacances au soleil. Tout indiquerait un parfait retour à la normale s’il n’y avait de la part de tous un si notable empressement à le simuler. A faire comme si rien ne s’était passé, comme si une tout autre normalité ne s’était imposée pendant deux mois d’occupation. Une normalité où les amphis sont des dortoirs, où les voisins sont des camarades ou des ennemis, où la lutte rend les êtres désirables, et non plus seulement séduisants ainsi que le veut la séparation coutumière. A vrai dire, tout ce petit monde universitaire en fait un peu trop. Il y a une fébrilité, une exagération dans les expressions, une maladresse qui trahit le travail en cours : refouler l’évidence qu’il pourrait en être autrement, que la vie ne ressemble pas nécessairement à cette course de hamster en cage.
Et en effet, il n’y a pas de retour à la normale. Ce qu’il y a, c’est un processus de normalisation : une guerre à outrance contre la persistance de l’événement. Nous ne parlons pas de simples prises de conscience, de faits aussi communément admis, sur la fin du mouvement, que la fonction policière des syndicats, le nécessaire recours à la casse, la joie d’une vie passée à bloquer l’économie plutôt qu’à se laisser formater pour un jour la servir ou le retour du feu comme pratique politique élémentaire. Nous parlons d’amitiés. Toute amitié conserve une trace des conditions de sa naissance, du moment de la rencontre. Celles qui se sont nouées là garderont toujours une odeur de lacrymo, un petit éclat de voiture qui flambe, de vitrine qui tombe, une lointaine rumeur d’émeute ; qu’elles ramèneront. Les syndicalistes, les gauchistes, les militants ont vécu un mouvement social. Un de plus.
Les « mouvements sociaux », dans leur rituel cent fois répété et toujours défaits, sont une tolérance locale. Ils appartiennent au folklore de ce pays. « Pour notre honte », disent les uns, « pour notre gloire », pensent les autres. Dans tous les cas, ils font partie de la gestion démocratique à la française,
dont ils sont le moment carnavalesque, après quoi tout rentre dans l’ordre. Les gouvernants peuvent bien jouer les monarques tant qu’ils laissent à la population le droit de mimer 1789.
Nous, nous avons vécu un événement. Un événement se reconnaît aux intensités qu’il produit - dépaver ensemble, à coups de grilles d’arbres, une place à touristes, coordonner une attaque au cocktail Molotov, discuter d’un texte jusqu’au petit matin -, non moins qu’aux failles qu’il dessine, aux possibles qu’il dévoile. Ce que nous voulons consigner ici, c’est ce qui a été acquis là d’irréversible, ce sur quoi aucune « fin de mouvement » ne peut revenir, ce qui fait des derniers mois non une parenthèse dans le cours régulé de la vie sociale, mais une seconde vague, après l’incendie de novembre, dans la douce montée d’une onde insurrectionnelle.


1.
Un slogan entendu à Rennes : « Nous ne sommes pas des pacifistes. Nous livrons la guerre au capitalisme ». Tout le cortège le reprend. Plus tard, des pacifistes défendent un rang de flics à coups de poings paradoxaux. Finalement, ils sont chassés de la manifestation. Une banderole : « Nous
sommes tous des casseurs », votée par l’assemblée de Rennes 2, qui devient à Paris l’antienne d’une manif sauvage où locaux du PS, de Charlie Hebdo, banques et agences d’intérim sont équitablement fracassés.
2.
Il n’y a pas de question de la « violence », il n’y a qu’un parti pris dans une guerre déjà en cours, et la question, alors, des moyens adéquats à la victoire.
3.
Durant toute la durée du mouvement, on aura assisté à cette constante opération policière de distinguer entre bons manifestants et méchants casseurs. Au fil des semaines, à Paris, « casseur » aura d’abord voulu dire « anarcho-autonome s’affrontant avec la police devant la Sorbonne », puis
« incontrôlé venu en découdre avec les forces de l’ordre place de la Nation » et finalement « jeune des cités, cogneur de manifestant, dépouilleur de portable place des Invalides ». Au terme de sa dérive sémantique, le « casseur » ne cassait plus rien, il lynchait des manifestants. Le terme apparaît alors pour ce qu’il est : un signifiant vide à l’usage exclusif de la police. La police a ce monopole : forger le profil de la menace.
En désignant comme un sujet étranger au mouvement ses éléments les plus décidés, il coupe le mouvement de lui-même et de sa propre puissance, il le rend étranger à sa propre potentialité offensive, à son sérieux. Le profil de la menace, de nos jours, c’est l’immigré-criminel, le « barbare des cités ». En alléguant ainsi que tout « étranger » est un subversif en puissance, ON veut d’abord insinuer qu’un bon Français n’a aucune raison de le devenir ; quand jamais, en réalité, n’ont été si nombreux ceux qui ne se sentent plus chez eux dans le funèbre décor de la métropole capitaliste.
4.
Bien entendu, scander « nous sommes tous des casseurs », ce n’est pas s’affirmer en tant que sujet « casseur », mais seulement déjouer l’opération policière en cours. Admettre la casse comme pratique politique, c’est manifester l’existence quotidienne des banques, des vitrines ou des magasins branchés comme moment d’une guerre silencieuse. C’est détruire en même temps qu’une chose, l’évidence attachée à son existence. C’est rompre, enfin, avec la gestion démocratique du conflit, qui s’accommode si bien de manifestations contre ceci ou contre cela, tant qu’aucune prise de position n’est suivie d’effets.
5.
Nous parlons d’opération policière. Distinguer, dans cette police, entre gendarmes, syndicalistes, journalistes, bureaucrates et politiciens est superflu tant leur collusion fut ici patente. Les clichés des journalistes ont servi les enquêtes de la police tandis que le service d’ordre de la CGT matraquait nos camarades et les livrait aux CRS, s’en flattant au passage dans les journaux du lendemain. Tous auront collaboré à cette oeuvre : faire consister la scission entre « casseurs » et « manifestants ». Et ils n’y seront vraiment parvenu qu’une fois, à Paris, le 23 mars. Partout ailleurs l’indistinction tant redoutée par le ministre de l’Intérieur - « s’il y avait connexion entre les étudiants et les banlieues, tout serait possible. Y compris une explosion généralisée et une fin de quinquennat épouvantable » - a fait des merveilles. Strasbourg, Nantes, Grenoble, Toulouse, Rennes, Lille, Drancy, Caen, Rouen, jamais, dans l’histoire récente de la France, les centre-ville n’auront connu de si régulières soirées d’émeutes.
6.
Le 21 mars, une manifestation étudiants-lycéens qui se termine au Luxembourg. A l’avant un groupe de 200 gars des cités, et tout au long du parcours un service d’ordre qui se resserre en cordon sanitaire dès que s’approche une bande. Finalement, les bureaucrates décident de détourner le cortège avant l’arrivée, laissant le groupe de tête entre les CRS et les équipes de civils. Deux jours plus tard, Invalides. Une manifestation plus blindée que jamais est prise pour cible de dépouille et de lynchage par ceux qui en avaient été si aimablement tenus à l’écart. Va comprendre !
7.
Deux façons de se mouvoir dans la rue, dans la rue devenue espace hostile, propriété des flics, des automobiles et des caméras : le cortège et la bande. Le cortège : on arrive individuellement, on se joint pour quelques heures à ses « camarades », on braille quelques slogans auxquels on ne parvient plus à croire, les jours d’enthousiasme on chante des chansons qui feraient froid dans le dos si elles voulaient encore dire quelque chose, comme L’Internationale. Une sono vient avantageusement couvrir le mutisme de l’assemblée, et le vide des relations. Manu Chao, Zebda, La Brigada, etc. Puis chacun regagne, individuellement, son chez-soi où il a tout loisir de n’en penser pas moins. Promenade digestive pour bétail syndiqué, défilé de solitudes garanties par un service d’ordre. La bande : on débarque ensemble. On a pris un peu de matos. On a une petite idée de ce que l’on est venu faire là. Se taper avec les flics, brûler Paris, libérer la Sorbonne, dépouiller des magasins, des portables, se faire des journalistes ou des manifestants. On se meut comme un seul homme, à cinquante. Si l’un court tout le monde court, si l’un tape tout le monde tape, si l’un se fait taper, pareil. Réflexes de horde. Jargon commun. Disposition à la bêtise, au suivisme, au lynchage. Extrême mobilité. Hostilité à l’inconnu, à l’immobile. Plusieurs fois, dans les dernières années, ces deux façons de se mouvoir se sont rencontrées à Paris. Le 8 mars 2005, notamment, puis aux Invalides. Chaque fois, la confrontation a tourné à l’avantage des bandes. Chaque fois, l’individu séparé des cortèges, avec sa liberté d’expression, son droit à être lui-même, à avoir son portable, son compte en banque et ses dreadlocks, s’en est tiré meurtri, traumatisé. Traumatisé par des gamins de quinze ans. Traumatisé par une cruelle alternative : s’organiser à son tour en bande ou bien finir sur le carreau. A moins de prendre son parti de cette vérité : l’individu libéral a la police pour condition. C’est cette évidence que l’ON a voulu dénier, après chacune de ces confrontations, par un brutal accès de mauvaise foi.


8.
La communauté ne s’éprouve jamais comme identité, mais comme pratique, comme pratique commune. L’identité revient au galop chaque fois que la pratique se retire. Là où l’on occupait, là où l’on cassait, là où l’on tagguait, là où l’on retournait les voitures, il n’a jamais été question de provenance sociologique, de lycéen de banlieues ou d’étudiant petit-bourgeois.
9.
Le CPE fut d’abord un prétexte. Prétexte à mobilisation pour les organisations syndicales, prétexte à blocage pour les étudiants, prétexte à rébellion pour beaucoup. Puis, devant la hogra gouvernementale, le CPE devint un point d’honneur. Si bien que son retrait n’a nulle part été vécu comme une victoire, mais comme le simple effacement d’une offense. L’affect dominant du mouvement, ce fut le sentiment qu’on se fout de votre gueule, le sentiment d’être floué. Affect réactif, modéré mais puissant. Et c’est en vertu de cette modération que le mouvement en est venu à des pratiques radicales, à des pratiques à hauteur de la guerre de l’époque : l’attaque de la police et le blocage de l’économie. Par là, il a rejoint les piqueteros argentins, les insurgés d’Algérie et les émeutiers de novembre.
10.
Le contenu d’une lutte réside dans les pratiques qu’elle adopte, non dans les finalités qu’elle proclame. Nous parlons ici de « prétexte » parce que lorsque nous chargions les CRS au cri de « retrait du CPE », nous aurions pu pousser n’importe quel autre cri de guerre pour nous donner du courage ; et que nous n’étions pas seuls à scander « CPE, on s’en fout, on veut pas bosser du tout » en envahissant les voies ferrées. Le contenu effectif du mouvement fut donc le blocage total de l’économie et l’attaque des forces de l’ordre, l’interruption de la circulation marchande et l’affranchissement du territoire de son occupation policière. Vouloir en tant que tels les moyens que l’on se donnait alors, c’était entrer dans le processus insurrectionnel. A quoi la forme « mouvement » ne convient pas. A quoi une certaine inconsistance étudiante ne prédispose guère. Qui suppose, surtout, l’âpre détermination à s’organiser matériellement.
11.
La lutte contre le CPE aurait été une lutte contre « la précarité ». C’est ce qu’en disent les syndicats : « la précarité », vocable confus et opportun, leur évoque on ne sait quelle déchéance biblique frappant le salariat, et dessine ainsi en creux leur propre attachement à l’ancien ordre du travail. C’est ce que disent les journaux, qui ne comprennent rien. Et c’est ce qu’en disent les récupérateurs négristes, qui y voient un nouveau pas vers l’inéluctable « revenu garanti », comique synthèse du socialisme et de la cybernétique. Les slogans du mouvement n’auront certes pas ajouté à la clarté du débat. Au réflexe débile qui consistait à déduire du « CPE, non, non, non » un « CDI, oui, oui, oui », c’est-à-dire à défendre le statu quo de l’exploitation au motif que celle-ci s’aggrave, le réflexe radical aura été d’opposer un « ni CPE, ni CDI ». D’avancer, contre le simple « refus de la précarité », le « refus du salariat ». Et l’on a bien vu flotter sur le Collège de France occupé une banderole disant « CPE ou CDI, c’est toujours le STO ». En réalité, ce qui se joue sous le terme-écran de « précarité », ce n’est pas une simple dégradation du salariat classique, mais la redéfinition même de ce qu’est le travail. Si travailler a longtemps voulu dire « faire ce que l’on vous dit de faire », travailler signifie désormais « être qui l’on vous dit d’être ». N’importe quel stagiaire sait les sourires qu’il doit feindre, le sabir managérial qu’il faut avaler, l’enthousiaste soumission qu’il doit afficher, c’est-à-dire le masque qu’il doit revêtir, pour se faire accepter du monde de l’entreprise. Il sait combien s’intégrer à la société veut seulement dire s’intégrer la société, et s’intégrer à l’entreprise, s’intégrer l’entreprise. Or la période d’essai de deux ans que prévoyait le CPE, c’est exactement le temps qu’il faut pour devenir le masque que l’on porte, pour s’incorporer, à force de mimer, la figure attendue. Si le salariat classique a été si peu critiqué, finalement, dans le mouvement anti-CPE, c’est que cette critique a déjà été largement faite, et en pratique, par le capitalisme. Tout ce management participatif, toutes ces « tâches enrichies », toute cette individualisation des horaires et des conditions de travail, toute cette rhétorique de la motivation sont déjà une réponse à la crise du salariat classique dans les années 70, quand tout une génération refusait massivement de travailler. Ce qui a été rejeté dans le CPE, ce n’est donc ni le salariat ni sa crise, mais la redéfinition du travail qui résulte de cette crise, c’est l’élément d’assujettissement du travail contemporain, ce par quoi il nous mobilise subjectivement, en vient à nous constituer un Moi socialement calibré. Le licenciement sans motif ne faisait que sanctionner ce nouveau régime où l’on vous vire pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites, pour l’écart par rapport à une norme de conduite et non pour l’infraction à une clause de contrat. Si bien que le slogan « CPE, non, non, non /CDI, oui, oui, oui » exprimait moins le désir servile d’être exploité huit heures par jour comme tout le monde que le refus de laisser le travail nous former, de le laisser pénétrer de nouvelles épaisseurs de l’être. Si le travail n’est plus centralement l’échange contractuel d’une somme d’argent contre une portion de temps, mais cet usinage maniaque de subjectivités conformes en vertu de quoi un mannequin qui ne fait jamais rien ne cesse jamais de travailler, alors l’instrument de la grève générale peut être laissé au musée. Vient le temps de la grève humaine, où l’on commence par cesser d’être qui l’on doit être, où l’on se lie par-delà les identités et les codes existants, où l’on fait sauter tout l’univers du prévisible. Vient le temps où ce sont, pour comble, ceux qui ne travaillent pas qui inventent les nouvelles formes de la grève.
12.
Le blocage des universités n’a pas été seulement un moyen de perturbation, une prise de possession. Il a été un préalable, le moyen pour les bloqueurs de s’organiser, d’ouvrir la porte à de nouvelles situations. Bloquer la fac pour aller bloquer ailleurs. Rapidement, libérés des tracasseries universitaires, étudiants et lycéens ont propagé leur désir que tout s’arrête. Au lieu de supplier les centrales syndicales de déclarer la grève générale, ils ont propagé sur les rails, les routes, dans les bureaux et les centres commerciaux la grève humaine. Ce qui est vrai pour les facs est aussi vrai ailleurs : sur une rocade, quand des milliers de conducteurs s’arrêtent, éteignent leur moteur, osent enfin sortir de leurs véhicules, pour discuter autour d’un feu de palettes ; dans un centre de tri quand le blocage des camions permet l’émergence d’une parole commune, vite muselée par l’intervention du GIPN. Toute cette société fait songer au Surmâle de Jarry : c’est un cadavre dont on ne pourra constater la mort que lorsque l’on aura arrêté la machine. C’est pourquoi monte de chacun de ses rouages le désir que tout s’arrête, et c’est pourquoi ses gestionnaires ne reculeront devant rien pour la faire tourner toujours.

13.
Tant qu’existaient des organisations et un programme révolutionnaire, seule importait la finalité. Pour la révolution, tous les moyens étaient bons. Puis sont venus, avec la perte de toute perspective révolutionnaire, les mouvements sociaux ; où l’on s’agite et se congratule d’être « tous ensemble », sans plus savoir exactement à quelle fin. Et comme la fin fait défaut, les moyens eux-mêmes se mettent à flotter. On ne sait plus trop comment faire, on fait des expériences. On se tape un peu avec les flics, on manifeste un peu sauvagement, on s’amuse bien pendant l’occupation et puis quand tout retombe on retourne à ses études, à son destin individualisé et l’on s’est fait quelques potes. Les mouvements offrent ce confort de ne pas trop engager : ils ont un début, un apogée et un dénouement. Et quand le pouvoir sonne la fin de la récré, on n’a pas trop de scrupule à retourner dans le rang : on
n’en était pas trop sorti. Nous, nous disons que là où nous éprouvons de la joie, là est notre destin ; que les fins sont immanentes aux moyens ; qu’il faut s’attacher aux pratiques qui nous comblent de joie comme à nous-mêmes. « Et l’instant où j’ai été moi-même est effectivement la vie, la vie elle-même, la vie complète. » Nous avons entrevu dans le blocage de l’économie et l’anéantissement de la police l’étincelle d’une vie historique à quoi rien ne nous fera renoncer, quoi qu’il advienne.
14.
Hannah Arendt notait en 1970, au sujet des agitations étudiantes de l’époque : « La stérilité théorique de ce mouvement et la pesante monotonie de ses analyses sont d’autant plus frappantes et regrettables que sa joie dans l’action fait plaisir à voir (…) Ce qui peut le plus fortement faire douter de ce mouvement, en Amérique et en Europe occidentale, c’est une sorte de curieux désespoir qui en paraît inséparable, comme si tous les participants étaient d’avance convaincus que leur mouvement sera écrasé. » Une revue - L’Antenne - commentait en 1987 le mouvement étudiant de 1986 dans ces termes : « Tout semble se passer comme si l’état de la société était devenu extrêmement favorable au surgissement de mouvements de rue qui sont exclusivement des mouvements "d’expression", comme on dit : soudains, spectaculaires, énormes et, surtout, sans lendemain. » Plus que d’autres, les mouvements étudiants semblent grevés de cette néfaste idée de mobilisation, qui contient comme son envers dépressif le nécessaire retour à la normale. En se mobilisant, c’est-à-dire en négligeant, dans la lutte, de nous organiser sur la base de nos besoins, qui ne sont pas seulement besoin de dormir et de manger, mais besoin de penser, d’aimer, de bâtir, d’étudier et de se reposer, d’être seul ou de faire bloc, en se mobilisant, c’est-à-dire en mettant entre parenthèses tout cela, en mettant entre parenthèses tout ce qui nous attache à la vie, en négligeant de s’en saisir collectivement, nous nous assurons que viendra le moment d’épuisement où chacun verra dans la fin de la mobilisation une heureuse retrouvaille avec les habitudes délaissées, avec les passions cruciales, le tout sous l’infect signe du privé. C’est au contraire par le souci de s’organiser sur la base de nos besoins que se construit, de crise en mouvement, le parti de l’insurrection.

15.
Dans un monde de flux, le parti de l’insurrection ne peut être que parti du blocage, du blocage physique de toute la circulation marchande, mais parce que ce monde de flux est lui-même le monde de l’absolue séparation, le parti de l’insurrection doit aussi être parti de la communisation, parti de la mise en commun. Tôt ou tard, il nous faudra bien bloquer Rungis, mais nous ne pourrons bloquer Rungis qu’à condition d’avoir dans le même temps résolu à l’échelle locale la question du ravitaillement, d’avoir établi les solidarités nécessaires. S’il ne s’était agi que de contester le CPE, l’assemblée souveraine aurait pu passer pour une forme d’organisation convenable. Mais si c’est un monde à l’agonie qu’il s’agit d’abattre, la forme élémentaire de l’auto-organisation est la commune. La commune en tant que niveau où l’organisation du blocage et celle de la vie partagée se rejoignent. Où l’on peut tout bloquer parce que l’on ne dépend plus de la circulation générale, où l’on ne dépend plus de la circulation générale parce que l’on s’est organisé pour tout bloquer. Il pourrait apparaître, dans le cours de cette reprise du territoire, que la métropole contemporaine, entièrement structurée par les flux, n’est compatible avec aucune forme d’auto-organisation, et qu’elle doit donc être détruite de part en part. L’expérience du processus insurrectionnel argentin de 2001, borné par l’extrême dépendance, notamment alimentaire, de Buenos-Aires, en porte témoignage.
16.
Partout en France, dans le sillage du mouvement, des bandes se sont formées, des maisons ont été squattées, des noyaux se sont constitués. Ils ne sont pas le fait d’anciens combattants, mais de ceux pour qui la lutte n’a pas été moyen d’une fin, le retrait du CPE, mais moyen pur, forme désirable de la vie. De ceux qui ont éprouvé la seule communauté accessible, peut-être, dans la métropole : celle que fonde la lutte pour sa destruction. D’année en année, de mouvement lycéen en vagues d’incendies nocturnes, nous voyons imploser ce qu’il reste de cette société et, dans le même mouvement, s’agréger un substrat toujours plus vaste, toujours plus dense de déserteurs. La question est : comment la désertion devient conspiration ? Comment des bandes deviennent une force ? Quel type de force peut opérer le passage d’une situation de crise, de mouvement, à une situation insurrectionnelle ? Ceux qui douteraient de notre capacité à intervenir d’une façon historiquement décisive feraient bien de se rappeler comment dans les villes les plus remuantes - Rennes, Rouen, Caen, Grenoble, Nantes, Strasbourg - un nombre infime de subversifs organisés a suffi à changer du tout au tout la texture locale du mouvement.
17.
L’évanouissement éclair du mouvement s’explique aisément. Refusant d’identifier les syndicats, les médias, l’administration, les anti-bloqueurs comme des ennemis, et refusant de les traiter comme tels, le mouvement les a laissés en devenir une composante. Il a fait des AG avec eux, il les a parfois hués, mais il n’a jamais lutté contre eux, se figurant comme consensus de la société civile contre le gouvernement. C’était une question de démocratie. Si bien que lorsque tout ce beau monde a déclaré d’une seule voix la victoire et l’enterrement du mouvement, le vide s’est fait autour de nous : nous n’étions plus qu’une poignée d’irréductibles à découvert.
18.
A l’évanouissement du mouvement, après l’annonce du retrait du CPE, ont répondu deux réflexes caractéristiques : le réflexe militant et le réflexe activiste. D’un côté les croque-morts du mouvement appelaient à se remobiliser, sans trop y croire eux-mêmes, et tentaient, au travers d’un quelconque « collectif de convergence des luttes » ou de « lutte contre la répression » de recruter un peu de la chair fraîchement politisée. C’est le même réflexe qui préside maintenant aux divers rassemblements de dépressifs d’obédience trotskyste, anarchiste ou autonome qui essaient de donner un avenir à un mouvement qui se sera bien passé d’eux tant qu’il était vivant. De l’autre on voit gigoter tout un ensemble de groupes d’actions qui rêvent de reproduire ce qu’ils ont vu ailleurs et qu’il faudrait déjà dépasser, qui mettront quelques semaines ou quelques mois encore à épuiser, à force de volontarisme, ce qu’ils conservent de l’esprit du mouvement. Les uns bavardent, mais les autres travaillent.
19.
Le mouvement n’a cessé de trébucher sur deux questions qui, pour finir, lui donnèrent le coup de grâce : la démocratie et l’assemblée générale. Alors qu’il n’avait fallu que quelques dizaines d’énervés, au début du mouvement, pour bloquer un amphi, un bâtiment, une fac, ce furent lors des votes de déblocage 500, 1000, 2000 personnes qui durent s’effacer devant la « souveraineté » de l’assemblée générale. Bien souvent, c’est là, face à toute l’absurdité du jeu démocratique, que se sera dévoilée la nature de l’affrontement recouvert par la question du blocage. Entre bloqueurs et anti-bloqueurs, après le vote, on en sera enfin venu aux mains.

20.
L’assemblée, comme pratique, nous remonte d’époques où la vie, et donc la parole, étaient chargées de communauté. Communauté ouvrière ou paysanne, guerrière ou populaire, guayaki ou hassidique. Il y a toujours eu une théâtralité, une grégarité, un panoptisme, des enjeux de mainmise, de contrôle, d’hégémonie, dans les assemblées. Il n’y a plus maintenant que cela. C’est pourquoi elles sont fuies. C’est pourquoi, là où n’a pu naître une assez large communauté de lutte, les AG se tenaient sans rapport avec ce qui se passait dans la rue. Inadéquate à la pensée libre comme à l’organisation de l’action, ignorante de l’amitié, l’assemblée est une forme vide, un simulacre bon à tout, et à rien. Devant cette évidence, des camarades ont appelé, dans le cours du mouvement, à les déserter pour former des bandes. Ils ont opposé assemblée et communauté. C’est une erreur. On n’appelle pas à la communauté ; elle survient, comme une bande se forme, sans décision préalable. Si la parole tourne à vide dans les assemblées générales, ce n’est pas à cause des tours de parole, des tribunes, des bureaucrates, c’est à cause de ce qui rend les tours de paroles, les tribunes et les bureaucrates possibles : l’absence de toute communauté entre les êtres.
21.
Nous avions dit que nous reviendrions. Nous sommes revenus. Sur la Sorbonne brièvement réoccupée, une banderole claquait au vent. On y lisait, dans ce soir d’orage : « Les mouvements sont faits pour mourir. Vive l’insurrection ! ».
22.
Vendredi 31 mars. Allocution sénile de Chirac. Des rassemblements spontanés en plusieurs points de Paris. Qui se cherchent, se trouvent, convergent sur l’Elysée, refluent, obliquent, pour éviter la gendarmerie mobile. 3000 personnes de 8 heures du soir à 4 heures du matin. Une errance sauvage de
25 kilomètres. Foule de tous âges, de toutes tendances, idéalement désarmée, désemparée par sa propre puissance sans emploi. Qui passe le pont de la Concorde, arrive sur l’Assemblée Nationale avant les flics, qui y serait entrée si elle avait eu ne fût-ce qu’un pied-de-biche. Qui faillit forcer les portes du Sénat. Passe devant le Palais de Justice. Qui remonte vers Barbès et ravage tout ce que les boulevards de Sébastopol et du Magenta - le fameux « espace civilisé » du Magenta - recèlent de banques, d’agences d’intérim, de brasseries branchées, au cri impérieux de « Paris, debout, réveille-toi ! ». Puis qui salue les prostituées de Pigalle, monte vers le Sacré-Coeur - « Vive la Commune ! », entend-on dans les bouches avant de le lire, taggué sur l’ignoble édifice -, échoue, là aussi, à y entrer pour l’incendier. Feu de joie, donc, devant le Sacré-Coeur. Un dernier Mac Do vole en éclat. Et sur le chemin de la permanence de Pierre Lellouche, qui partira bientôt en miettes, cette dame d’une cinquantaine d’année accoudée en nuisette à son balcon, qui passe à tue-tête « Les mauvais jours finiront » - il est trois heures du matin. Nous avons parcouru ce soir-là, dans une récapitulation mélancolique, tout ce qu’il nous faudra, pour commencer, brûler.
Paris, juin 2006
Comité d’Occupation de la Sorbonne en Exil