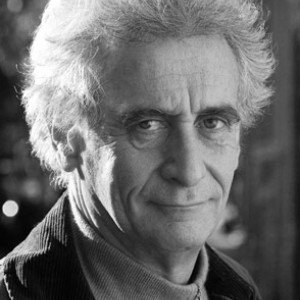Donc, pour peu qu’on ait regardé des écrans, on a été assailli d’armes et de larmes. Les sentiments mélangés devant le spectacle de guerriers étatiques surarmés s’agitant dans la lueur des gyrophares alternaient avec le chagrin des chiffres qui augmentaient, des embrassades éplorées, des témoignages hallucinées, plus tard des autels improvisés.
C’est une victoire incontestable de la terreur que de nous avoir placés, ne fût-ce qu’un moment, dans une situation où on ne pouvait que souhaiter que les flics fassent vite leur boulot de tueurs en tuant les tueurs djihadistes. C’est toujours une défaite, qu’il faut bien reconnaître, quand on en est à remettre le sort de ceux qu’on aime ou pour qui on sympathise, entre les mains des forces d’un ordre mortifère.
Quant au chagrin…
Les maîtres de nos affects
Comme nous l’avons déjà dit en janvier [1] , il faut savoir se laisser submerger par l’émotion. Une fois encore, ceux qui n’ont pas eu envie de pleurer en voyant les photos des massacrés du 13 novembre sont mal équipés pour affronter l’injonction à « ne pas expliquer », telle qu’elle est martelée par le premier ministre et le bataillon des éditocrates casqués. C’est en tant que sujets sensibles autant que rationnels que nous pouvons résister à leur discours de guerre, d’une guerre à front de taureau excluant la réflexion au nom de l’indignation morale et de l’efficacité. L’empathie pour les victimes rend d’autant plus insupportable la récupération de leur mort par une dramaturgie patriotique et guerrière. Le discours officiel et médiatique indifférencie les assassinés dans une icône générationnelle qui efface leurs singularités et tout ce qui, chez eux, pourrait résister à ce qu’on fait désormais en leur nom, assignations à résidence et bombardements compris. Comment croire, par exemple, que cette évolution aurait plu à Mathieu Giroud, géographe, qui critiquait les politiques publiques et la poudre aux yeux de la « mixité sociale » accompagnant l’embourgeoisement des quartiers populaires ? Comment savoir si Lola, 17 ans, n’aurait pas été d’accord avec son père qui a refusé d’assister à la cérémonie des invalides et écrit : « Le divorce entre les français et leurs dirigeants est accompli, le contrat social est rompu, le gouffre entre le peuple et les élites est béant. Les atteintes importantes aux libertés publiques, votées avec empressement par l’Assemblée Nationale, ne régleront rien » ? Combien d’entre eux auraient été agacés par tel commentaire à un article du New York Times qui a tant plu sur les réseaux et à France Culture et qui, comme le dit très bien Jérôme Ferrari, compile « les clichés les plus grotesques sur la France » en véhiculant l’idée que si ce pays a été attaqué c’est principalement parce qu’il est celui de l’odeur du pain chaud et des femmes en robe courte ?
Avoir de l’empathie pour ces morts signifie ne les réduire ni à un hédonisme consumériste, ni à aucune position qui nous conviendrait mieux. On peut sans risque parier que certains étaient capables de comprendre que la vie si légère aux terrasses des cafés se payait du pillage des richesses là-bas et de la précarisation-ségrégation d’une fraction de la population ici. On peut aussi supposer que certains avaient déjà entendu cette argumentation et s’en fichaient éperdument et aussi que la plupart des spectateurs du Bataclan ignoraient, tout comme les djihadistes (sinon ces derniers l’auraient mentionné dans leur revendication), que cette salle avait hébergé des soirées de soutien aux force armées israéliennes et que le leader du groupe de rock était un militant pro-armes à feu, soutien des républicains et de Donald Trump. On peut supposer beaucoup, mais en résumé, l’enrôlement des morts est toujours une opération honteuse – et ici tout particulièrement. Disons aussi au passage que le refus d’essentialiser ceux qui ont été tués évite les vaticinations sur les « bobos », cliché inventé par des néo-cons, qui interdit de penser avec un minimum de finesse les transformations des classes contemporaine. Il est vrai que le bataillon de médiatiques réactionnaires qui trustaient les écrans en se présentant comme des réfractaires réduits au silence par la domination des bobos, ont soudain oublié ce mot pour faire de la population des terrasses les martyres de leur croisade.
Accepter d’être ému et réfléchir sur ses émotions est un acte de survie dans un moment où plus que jamais la maîtrise des affects est un enjeu de pouvoir autant qu’une source de profits pour les maîtres de la communication capitalisée. L’importance de Facebook pour le recrutement de djihadistes vivant hors de Syrie et d’Irak est si grande qu’on peut dire sans exagération que l’entreprise californienne est coproductrice des morts vivants lâchés par Daesh sur l’Europe. Interdiction, jusqu’au ridicule, du dévoilement des corps, et indulgence pour les représentations de la violence : on notera d’abord que la morale promue par la machine de Zuckerberg, geek au sourire si doux, adepte des tenues cool et d’une profitable philanthropie, est étonnamment compatible avec le programme daeshien de communication, malgré toutes les suppressions de pages – d’ailleurs soumises à une certaine lenteur indexée sur des critères de profitabilité. Le dispositif électronique coproducteur des Walking Dead du djihad est aussi celui qui a su proposer sans délai de manifester par un clic qu’on était encore vivant (commande tout de même réservée aux rescapés de Paris, au grand dam de ceux de Beyrouth et autres lieux), avant d’enjoindre à ses clients de manifester leur solidarité en bleu-blanc-rouge. Dans un effort méritoire pour rester modéré, moi qui vomis toute forme de patriotisme, je dirais que le drapeau tricolore est, au minimum, un symbole ambigu : s’il fut celui de Valmy et de la Résistance, il a été aussi celui des Versaillais et des guerres coloniales. Ce qui n’a pas empêché un nombre impressionnant d’usagers du réseau, y compris ceux qui avaient jusque-là manifesté leur esprit critique à l’égard de Facebook ou du gouvernement, d’adopter dans l’instant une symbolique patriotarde plus proche des mœurs étatsuniennes que de l’humeur française contemporaine. Confrontée à l’échec de l’opération « drapeaux aux fenêtres » du 20 novembre, la réussite de cette opération a montré que Facebook est décidément plus fort que les gouvernements quand il s’agit de manipuler les émotions.
Si je me suis moi-même retrouvé sur Facebook, et si j’en fais aujourd’hui un usage parcimonieux c’est parce que j’ai découvert, en voyageant dans la Tunisie post-insurrectionnelle, dans les lieux reculés d’où tout était parti, que le « réseau social » était le principal outil de communication de la plupart des acteurs de l’insurrection arabe, et si je voulais maintenir le contact avec eux, il n’y avait pas d’autre moyen. Ceux qui ne sont pas « sur » Facebook peuvent toujours dire qu’ils ne se sentent pas concernés par les considérations qui précèdent – mais l’influence de ce réseau est telle qu’il a d’ores et déjà une influence sur leur vie. Tôt ou tard, les plus volontairement distraits le sentiront passer.
Facilitant la production des tueurs aussi bien que la réaction à leurs actes, rentabilisant à son profit le lien social, y compris avec ceux qui veulent le recomposer en collectivité émancipée des monopoles comme le sien, et avec ceux qui veulent le transformer en lourde chaîne théocratique, la firme a montré la place qu’elle occupe aujourd’hui, avec Twitter, Google et quelques autres : parmi les maîtres du monde.
Gouvernement de l’antiterrorisme
Voilà un moment qu’on le dit sur tous les tons et sur tous les supports dans les divers courants de notre parti [2] : l’antiterrorisme est devenu un mode de gouvernement, c’est même devenu le seul où les dirigeants, désormais simples serviteurs de l’économie libérale, peuvent encore avoir une sorte de pouvoir. Ce que des journalistes ont pu appeler sans frémir l’« effet d’aubaine » des massacres du 13, a permis aux gouvernants hexagons de sortir de l’impasse du plan Vigipirate, né le 2 janvier 1991 au déclenchement de la première guerre du Golfe. Dans La politique de la peur [3] j’ai décrit comment ce dispositif de propagande gouvernementale, s’il avait des effets nuls pour la protection des populations, a surtout servi, outre à arrêter quelques pickpockets, à habituer les populations à la présence de soldats dans les lieux publics. Censé manifester l’activisme protecteur du gouvernement, le dispositif était par nature condamné à la surenchère, à chaque fois qu’un nouvel attentat dévoilait sa parfaite inutilité. Dans sa dernière phase (« écarlate », puis après le renoncement aux codes couleurs, « Alerte attentat »), il était bloqué à l’alerte maximum, car quel gouvernement aurait jamais osé le faire redescendre d’un cran, au risque de se voir reprocher d’avoir baissé la garde ? Avec la proclamation de l’état d’urgence, on franchit un nouveau seuil dans le devenir-Israël de la société française : militarisation de la vie quotidienne et ségrégation de citoyens de seconde zone, les habitants des quartiers populaires étant bien partis pour jouer le rôle des arabes israéliens. Les relents de Guerre d’Algérie qu’apporte l’état d’urgence n’ont pas échappé à une police toujours prête à se comportercomme les flics de Papon, pourvu qu’on lui lâche la bride. L’extension aux contestataires de la COP21 de mesures censées lutter contre le djihadisme montre que la dynamique inexorable de ce dispositif, comme tous les dispositifs sécuritaires (des fichiers aux lois de surveillance) censés viser d’abord une catégorie particulière, est de s’étendre ensuite universellement. Dans le temps aussi : comme il était dans la nature du plan Vigipirate d’aller vers le niveau maximal pour s’y maintenir sans plus jamais redescendre, l’état d’exception actuel a pour vocation de devenir permanent.
Comme les bombardements là-bas, qui en touchant d’abord les populations civiles, tendent à les souder autour de l’EI, cette évolution ici conforte le programme daeshien d’aggravation de la séparation d’une partie des classes populaires. Facebook et le gouvernement s’avèrent coproducteurs du cours apocalyptique que Daesh entend donner à l’histoire.
Les fanatiques de l’apocalypse
Deux types de contenus internet jouent un rôle essentiel dans l’attrait de Daesh sur les aspirants djihadistes : la pornographie de l’horreur et le mythe de la fin des temps. Dabiq, l’organe central de Daesh (en anglais, le périodique francophone, moins bien fait, s’appelle Dar al-Islam) est un magazine online singeant dans sa maquette les grands de la presse internationale. Son titre est le nom d’une localité près d’Alep que l’organisation s’est furieusement attachée à conquérir, malgré son peu d’intérêt stratégique. “Nous enterrons le premier croisé américain à Dabiq et nous attendons avec impatience l’arrivée du reste de vos armées”, a proclamé un bourreau masqué dans une vidéo de novembre 2014 montrant la tête tranchée de Peter Kassig, travailleur humanitaire qui était retenu en otage depuis 2013. Présente dans les trois monothéismes nés dans la région, la tradition apocalyptique était plutôt l’apanage des chiites mais elle a été réactivée par l’EI à partir d’un haddîth (dit attribué au prophète) qui prévoit que la bataille de la fin des temps se livrera là. Et qui descendra du ciel pour aider les musulmans à remporter la victoire ? Jésus, un des prophètes de l’Islam, comme chacun sait !
Car ce n’est pas seulement chez l’EI que l’imaginaire de l’apocalypse joue un rôle déterminant. Le sionisme chrétien, doctrine de multiples églises protestantes américaines (40 millions de fidèles), incarné sur le plan médiatique par des télévangélistes vedettes, a joué un rôle déterminant, à travers l’influence des néoconservateurs sur le gouvernement Bush dans l’irrationnelle [4] intervention américaine en Irak, qui fut le creuset de la naissance de Daesh.
Issue d’une lecture littéraliste de l’Ancien Testament et de l’Apocalypse, l’action politique bien réelle des sionistes chrétiens (ils financent par exemple massivement l’alya de juifs américains conservateurs, futurs colons en Palestine) joue un rôle certain dans l’impossibilité de tout recul critique de la part des gouvernement etatsuniens par rapport à la politique à la fois meurtrière et suicidaire des différents gouvernements israéliens depuis au moins trente ans. Il faut l’avoir présent à l’esprit pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui au Moyen Orient : en face des obscurantistes du djihad, la rationalité occidentale est principalement défendue par une armée dont les responsables sont soumis, entre autres influences, au programme de gens pour qui Israël doit être défendu avec ferveur jusqu’à la bataille finale d’Armageddon, juste avant laquelle les juifs devront se convertir au christianisme, sous peine d’être exterminés ! Si on ajoute à cela l’influence sur la politique israélienne d’une extrême-droite juive habitée elle aussi de prévisions apocalyptique, on comprend que la région du monde qui recèle aussi la principale réserve des ressources indispensables au capitalisme tardif, est aussi la source d’un imaginaire de la fin des temps, constitutif de l’Occident. L’ « Orient » n’a jamais été autant le cœur de l’ « Occident ».
A l’heure où les gouvernements montrent leur totale impuissance face à un réchauffement de la planète qui ranime très concrètement l’imaginaire du déluge, quand se diffuse partout la conscience qu’on va « dans le mur », les idéologies s’avèrent plus que jamais forces matérielles. Si nous ne voulons pas que les prophéties des divers fanatismes exercent des effets auto-réalisateurs, il nous appartient de nous réapproprier les récits de la fin. Penser la fin du capitalisme autrement que comme un « jugement dernier » pourrait être une piste. En tout cas, le premier mouvement de résistance à l’air du temps doit partir de la conscience que Daesh et l’Etat d’urgence sont constitutifs d’un seul et même monde - y compris dans le rance canton français, désormais dominé jusqu’au sommet de l’Etat par un imaginaire d’extrême-droite (la déchéance de nationalité, ça, Hollande, tu l’emporteras pas en Paradis, c’est le cas de le dire).