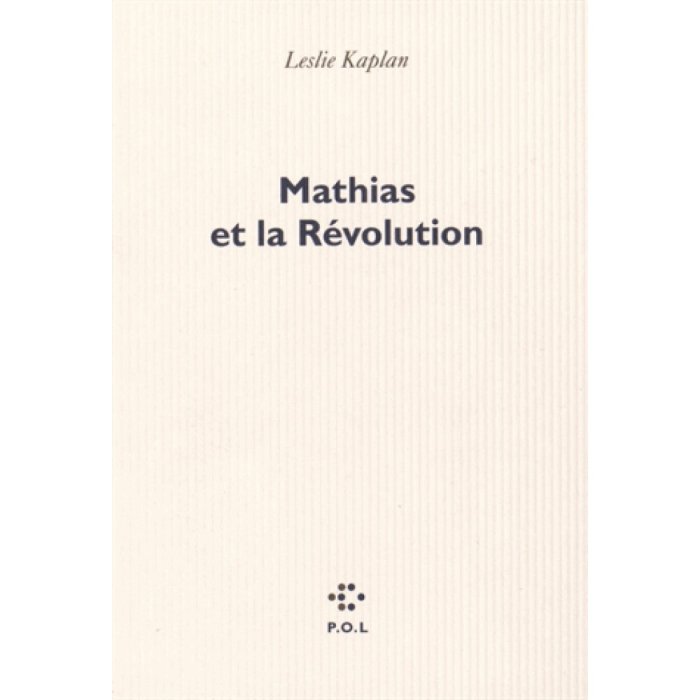- Nathalie Quintane : D’abord, j’aimerais savoir à quel moment vous est venue cette idée de crimes en série ?
- Leslie Kaplan : En février… Ça faisait un moment qu’il y avait tout un tas de bêtises qui étaient dites sur ce qui était en train de se passer, sur la violence… Je voulais que ce soit publié assez vite… C’est un texte écrit sur le moment. Ça me paraissait logique, de l’écrire et de le publier dans la foulée.
- Les criminels usent tous d’outils, des outils qu’ils ont sous la main — car les crimes ne sont pas prémédités —, et qui renvoient à leur travail.
- Je voulais que ces personnes viennent de partout, dans la société… Une petite qui travaille dans un grand magasin au rayon maquillage aussi bien qu’un paysan, qu’un instit’… Les outils venaient avec… L’instituteur qui étouffe son inspecteur avec l’éponge du tableau !
- Vous soulignez que tous ces meurtres sont individuels, marqués par l’individualisme… enfin, vous dîtes d’abord qu’ils sont « impersonnels », puis « individuels », puis qu’ils gagnent en abstraction… Avec beaucoup d’ironie, vous écrivez que c’était « de l’ordre du travail bien fait, du devoir accompli »…
- Je trouvais amusant et pertinent qu’il y ait un décalage avec la réalité. Ce n’était pas un mouvement, mais des crimes individuels, ce qui me permettait ensuite d’insister sur l’idée de crimes de classe — il n’y a aucun grief directement personnel, sauf qu’à chaque fois, on est concerné… C’était une façon de parler de l’implication de chacun. Par exemple, il est dit que le patron était « très gentil », qu’il « aimait la petite puce », son employée ; on peut croire que c’est un rapport d’empathie alors qu’en fait c’est un rapport patriarcal comme il y en a plein. Quant à l’abstraction grandissante des crimes, c’est que la question politique s’impose de plus en plus. Le premier « ça suffit la connerie », la première fois que cette phrase est prononcée, arrive à propos d’un député qui veut revenir sur les heures supplémentaires… C’est plus abstrait qu’un rapport direct entre un ouvrier et un patron.
- Le livre commence par la phrase : « Il y eut ce printemps-là une série de crimes particuliers, rapidement nommés dans la presse "crimes du XIXe siècle ". » Tout le texte tient un peu dans ce début, ce partage entre les actes et la manière dont ils sont rapportés dans les médias…
- La question de la lutte des classes, on essaye de l’effacer au maximum… Donc on renvoie au XIXe siècle, comme si c’était archaïque… Le terme qu’on trouve pour qualifier ces crimes, c’est le « mauvais esprit »…
- Ah oui, ça, c’est génial, c’est très drôle !
- C’est très bourgeois aussi, ça se veut neutre… Et ça fait sentir la force de l’idéologie, de la société… On ne peut pas se cacher que c’est à la fois très bête et très puissant.
- Dans Mathias et la révolution, paru chez P.O.L. en janvier 2016, vous écriviez « On n’a pas encore trouvé la suite. » Ces crimes (ou quelque chose de cet ordre-là) sont-ils une suite possible, voire obligée ?
- (rires) Soyons clair : ce qui est écrit est écrit ; ce qui est commis, c’est pas pareil ! Il n’est absolument pas interdit de penser, c’est une chose de base ; tout est possible au niveau de la pensée mais tout n’est pas possible au niveau des actes. C’est dit dans le livre d’ailleurs : est-ce que les criminels trouvaient un caractère exemplaire à leur crime ? Et il est répondu : non. Ne mélangeons pas…
- La forme que vous avez choisie, une sorte de conte, laisse jouer à plein l’implicite. Le narrateur-trice semble toujours du bon côté du manche, celui des dominants ; il n’y a que des indices brefs de ce que ça cafouille (la rareté des gares, par exemple)… Jamais la révolte actuelle, celle des Gilets Jaunes, n’est nommée — et pourtant elle est tout le temps là ; jamais la domination (médias, gouvernants, gros entrepreneurs…) n’apparaît nommément non plus — pourtant on les reconnaît.
- C’était prendre un point de vue « objectif », « neutre »… Choisir une position d’extériorité me semblait efficace. C’est l’une des formes de l’humour : on est dehors, devant l’absurde des événements qui se déroulent. Ça permet d’accentuer l’absurde.
- Pouvez-vous revenir sur l’importance « du détail, du saut et du lien » [1] dans Désordre. Vous avez dit que c’étaient des points importants dans votre pratique de l’écriture...
- Quand on écrit et qu’on cherche à « attraper le réel », c’est toujours le détail qui compte, parce que le détail est une condensation d’une quantité incroyable de choses. L’outil utilisé comme une arme… Le saut, c’est la fameuse phrase de Kafka : « Ecrire, c’est sauter en dehors de la rangée des assassins »… La fiction et l’écriture en général impliquent ce saut. Ce qui est écrit ou pensé n’est pas la même chose que ce qui est agi. Le lien, c’est avec tout ce qui se passe, dans le monde aussi bien que dans l’histoire ou la littérature. Les Gilets Jaunes ont mis le doigt sur plein de choses diverses, différentes, qui font lien avec plein de choses qu’on a dans la tête… ce qu’on a vécu … 68… les Nuits debout, etc. Évidemment, les Gilets Jaunes, c’est très différent de 68 : ça n’a pas démarré avec les étudiants, il n’y a pas d’occupations d’usines et pas de grève générale. Mais c’est un mouvement populaire qui est parti d’un détail minuscule… En 68, c’était les étudiants à Nanterre, la question des chambres des filles et des garçons… et crac, ça a mis en cause le fonctionnement universitaire, le savoir, la maîtrise… Les Gilets Jaunes sont partis de la question du prix de l’essence et puis se sont mis à parler de la démocratie, de comment on est représenté, qu’est-ce que ça veut dire, qu’est-ce que c’est que cette forme de démocratie qu’on connaît depuis longtemps, est-ce que ce n’est pas à bout de souffle, etc. Et la question de la parole, ça j’y tiens. Comment, lorsqu’il y a un mouvement, on se met à parler dans tous les sens, sans hiérarchie, à dire ce qu’on pense, à avoir une pensée associative et en même temps porteuse de vérités et de pertinence ; et puis on trouve à qui parler, on trouve des interlocuteurs. On est allé en famille, avec les petits-enfants, à Commercy, et c’était incroyable… Les gens parlaient de choses à la fois minuscules et fondamentales. Il y avait 75 délégations ! Et une volonté de clarifier les choses, concernant les accusations de racisme ou de sexisme...
Désordre est venu d’ailleurs juste après L’assemblée des assemblées, fin janvier.
- Dans Mai 68, le chaos peut être un chantier (P.O.L., 2018), vous écrivez que le déni est une forme de silence, une façon de faire taire, par des couches de discours…
- Je pense au 1er mai… à la Salpêtrière… on était à la manif… Quel mensonge grotesque… Là, c’est autre chose qu’un déni, c’est un mensonge flagrant.
- J’y étais. J’ai bien cru qu’on allait s’écraser sur ces grilles… Heureusement, il y a deux trois jeunes qui ont eu le bon réflexe, d’y grimper et de tout faire pour les ouvrir. Ce qui m’a étonnée, c’est que la plupart des gens autour de moi n’avaient pas du tout de protection, même pas un foulard…
- Ils ne se méfient pas. C’est le premier mai, merde ! On était entourés de gens qui venaient simplement manifester le premier mai. Les gens manifestent, et en même temps ils savent ce qui peut se passer, mais ils se disent que ça ira … C’est compliqué…
- « Ça suffit la connerie » : c’est le bandeau qui attire l’œil sur votre livre, dans les librairies. C’est aussi la phrase que se mettent à reprendre les criminels au moment de l’action, et qui s’oppose à celle des médias : « Mais ce n’est pas politique »… « Ça suffit la connerie », c’est la réponse du peuple, des citoyens, une réponse au déni du politique ?
- Le bandeau et la quatrième, c’est une idée de P.O.L. Dans le livre, la phrase vient d’un ouvrier fraiseur au chômage : il pousse sous un camion un député qui veut proposer une loi sur les heures supplémentaires… pour plus de compétitivité, etc… le discours néo-libéral absolu. Cette phrase, « ça suffit la connerie », c’est une réponse politique, et quand on ne veut pas voir que c’est une réponse politique, on est aussi dans le déni de ce que c’est que le politique. Le politique, ce n’est pas « en plus », ce n’est pas « à côté », ça traverse n’importe qui depuis toujours, depuis qu’on parle, depuis qu’on vit ensemble. Ça ne définit pas un programme. Mais c’est certainement une phrase politique.
- Mathias, Mai 68, Désordre… on a une trilogie… Il y a comme un retour assez puissant de la question de la révolution (au-delà des reprises du mot qui s’acharnent à le relativiser ou le détourner de son rôle de levier politique).
- La révolution, c’est comme la question du politique… elle est toujours là. Depuis mon premier livre, paru en 1982, L’excès-l’usine, où d’ailleurs il n’y a pas un mot sur 68… La révolution, c’est un point de vue. Il faut juste faire attention, quand on écrit, à ne pas en faire un mot creux. Ce n’est pas un ’retour’, en ce qui me concerne, dans la mesure où la question du changement du cadre de pensée a toujours été là… comment changer le cadre de pensée. L’excès-l’usine partait de la banalité de l’usine ; l’enjeu, c’était de montrer que c’était le summum de l’horreur. Le mot révolution n’est pas dans ce livre. Dans Le psychanalyste, là, ça concerne des individus… Tout d’un coup, il peut y avoir un tremblement de terre intérieur, quand tu entends quelqu’un te dire : « Oui, mais c’est peut-être le contraire ». C’est peut-être le contraire de ce qu’on pense. Comment, chez quelqu’un, s’ouvre la possibilité de penser autre chose que ce qu’il pense habituellement. Dans l’écriture, c’est ce qui m’a toujours intéressé. Mathias ou la révolution partait de cette envie de parler de la révolution française, de la manière dont elle peut avoir un impact aujourd’hui… et juste après la parution du livre…Nuit debout. Louise elle est folle, écrit sous Sarkozy, résonne vraiment maintenant.
- Est-ce que vous vous sentez parfois portée par ce qui se passe… Il m’arrive d’avoir des bouffées d’enthousiasme…
- L’enthousiasme, c’est toujours bien, c’est archi-important. Il y a des choses qui bougent, oui… Mais regardez par ailleurs comme ils sont forts… Bolsonaro, Trump…
- Quels films et quels livres récents vous semblent à la hauteur de l’époque ?
- La guerre des pauvres, d’Eric Vuillard, c’est bien. Le titre fait écho à ce qui se passe. Ça apprend des choses, ça fait réfléchir. Après, c’est à chacun d’en faire quelque chose… ça laisse une grande liberté au lecteur. L’ordre du jour, ça a plu aux gens du Goncourt… j’imagine que ce n’est pas pour les mêmes raisons qu’à moi ça m’a plu. Papiers, de Violaine Schwartz, c’est très bien, très simple… une transcription d’entretiens et la folie de l’administration, la bureaucratie. Quant au cinéma, Serge Daney, le fondateur de la revue Trafic, continue encore aujourd’hui à m’aider à penser, à tout penser, le monde, la société, le cinéma. P.O.L. a réédité tous ses articles, j’en relis régulièrement, par exemple, « Marché de l’individu et disparition de l’expérience ». J’veux du soleil de François Ruffin c’est un bon documentaire sur le mouvement des Gilets Jaunes. Mais j’ai vraiment eu un choc en voyant récemment tous les épisodes de La Flor, de Mariano Llinas, c’est un film extraordinaire, 4 fois 3 heures, comment à partir de la fiction on peut TOUT penser. Ça se passe en Amérique Latine, dans les années 80, chez les guérilleros, chez les espions, à l’Est, à l’Ouest, et c’est complètement actuel, terrible, poignant, comique, renversant.