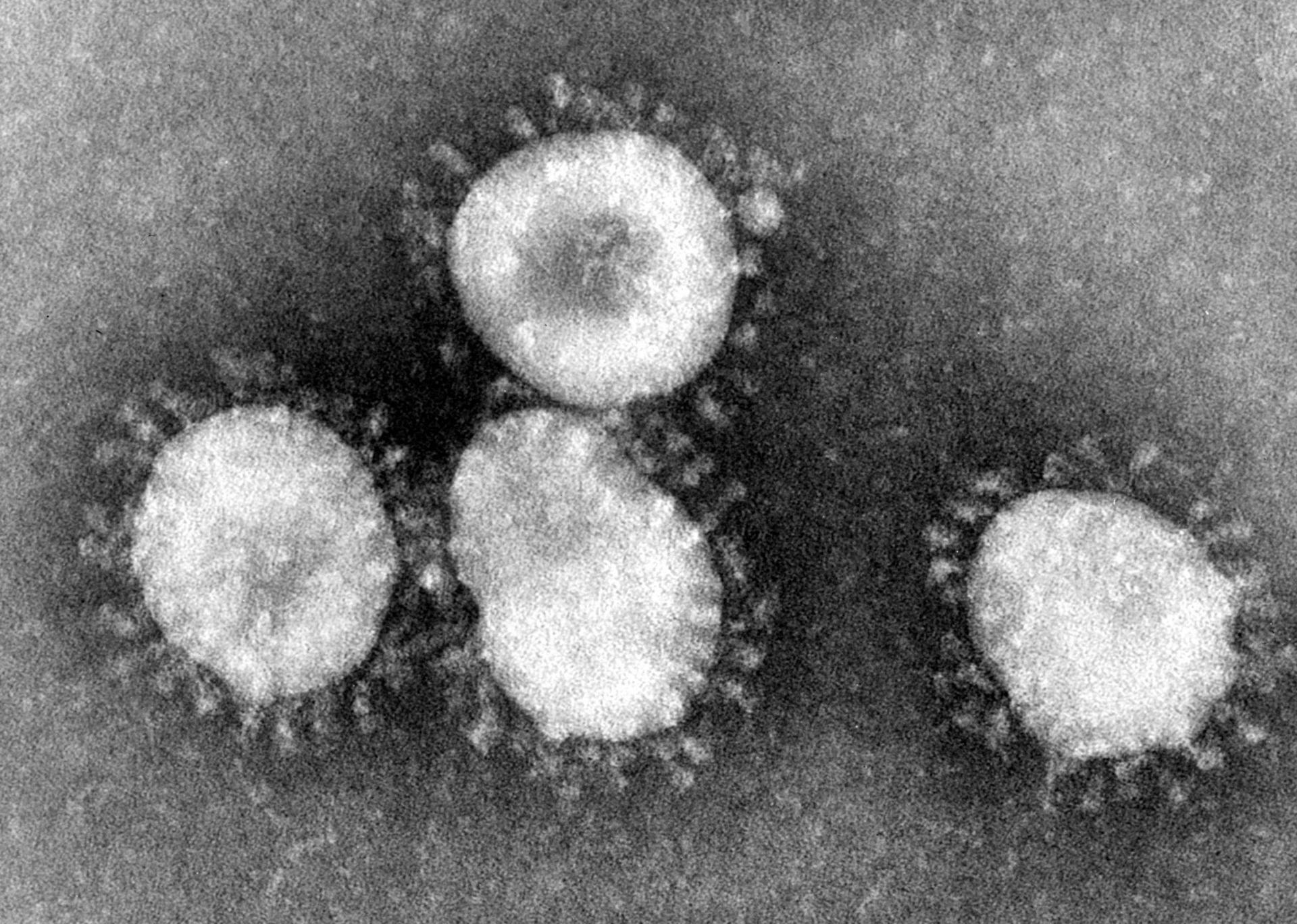« Plus c’est gros, plus ça passe ! », me dit-on en me confiant un énorme téléobjectif. Nous traversons l’immense parking en direction du Zénith. Refroidis par le nombre de cadavres endimanchés patientant à l’entrée, nous abordons un vingtenaire à la dentition parfaite. Vêtu d’un t-shirt blanc « En marche », il est membre de la fine équipe des organisateurs.
« Bonjour, nous venons couvrir le meeting, savez-vous où nous pouvons retirer nos accréditations ?
– Vous venez pour qui ?
– A priori, pour Macron, mais s’il y a Georges Marchais, on prend aussi !
– Non, je pense pas qu’il viendra… »
Visiblement, il n’apprécie pas notre humour, ou ne connait pas Georges Marchais. Nous la jouons profil bas pour nous présenter à la responsable des médias. Aucune carte de presse, lettre d’accréditation ou pièce d’identité, ne nous est demandée. Il suffit d’avoir son nom sur la liste, et par miracle, le mien se trouve ajouté en fin de page.

Une créature de vingt ans et quarante-cinq kilos me remet le précieux sésame, un badge vert orné d’un délicieux « La France qui subit ». Dotée d’une peau ne souffrant aucune imperfection, plus proche du plastique que de l’épiderme humain, elle me souhaite une excellente soirée avec un grand sourire. Je réalise alors que toute l’équipe de Macron semble tout juste sortir de chez le dentiste. Suis-je assez détartré pour me joindre à cette noble assemblée ?
Nous entamons un bref tour du propriétaire. La salle principale, ouverte sur un tiers seulement, indique qu’on attend peu de monde. Dans une sorte de balais mou, elle se remplit doucement d’un public que l’on peut classer en trois catégories : les évadés du gala de la faculté de droit, plastique parfaite et chaussures pointues, sorte de quintessence du Cercle des poètes disparus ; les rescapés de la maison de retraite, dentiers en aluminium et fronts figés au botox ; et la confrérie des milieux économiques locaux, féroces sourires de vainqueurs et chemises en soie.
Le messie tant attendu étant annoncé avec une heure de retard, nous gagnons la salle de presse avec l’intention de nous remplir la panse aux frais de Rothschild & Cie. Hélas ! ce qu’ils nomment buffet est d’une déconcertante modestie : une cafetière, une bouilloire, du thé et une poignée de cookies, ingurgités par la meute des journaleux en deux minutes. Ma déception est immense. Un autre, qui n’a rien avalé depuis midi dans l’espoir de se refaire sur le dos de la finance internationale, a l’air abattu, mais la noirceur de son regard semble prometteuse.

Pour nous distraire et « fixer les règles », un tour du carré presse nous est proposé, ou peut-être imposé, mais je confesse avoir oublié. Il s’agit d’une rangée de chaises minables, en contrebas d’une scène mal éclairée, à quinze mètres, dont nous serons séparés par la foule, dont on espère qu’elle ne va pas partir en pogo. Un photographe demande s’il est prévu d’augmenter la lumière.
« Mais c’est déjà énormément éclairé ! On ne peut pas en rajouter, sinon vous seriez tous aveuglés ! »
Un autre laisse alors négligemment tomber ses lunettes de soleil sur le nez. Rire général.
« En tout cas, c’est bien plus qu’au Mans, vous n’imaginez pas ! Et vos collègues ont fait de très bonnes photos…
– Certes, mais ils sont bien meilleurs que nous. Nous, vous savez, avec le soleil qu’on a ici, on sait pas travailler sans lumière. Nos boitiers sont bridés à 320 ISO. »
Passablement agacé, le type qui vient de lâcher cette petite pique est un mâle alpha du photojournalisme, trente ans de métier, quelques guerres et des centaines de meetings au comptoir, salarié d’une boutique à ménager quand on souhaite conquérir le pouvoir. Cela suffit pour inquiéter l’attachée de presse, qui tente aussitôt une diversion en désignant la ligne à ne pas franchir. L’une d’entre nous hasarde son pied au-delà de la ligne imaginaire et interroge : « Et ici, c’est bon ? » Nouveaux ricanements.
« Bah de toute façon, vous ferez ce que vous voudrez, vous faites toujours comme ça, vous, les journalistes ! »

Effectivement, tout le monde songe à faire ce qu’il voudra le moment venu. La majorité des photographes présents paraît se foutre royalement de l’autorité, des consignes et des espaces réservés, et la soirée s’annonce d’autant plus réjouissante. D’ailleurs, j’ai rarement observé une telle animosité envers les médias. Exception faite du Front national, on l’on vous accuse de promouvoir le « bolchevisme international » en vous distribuant avec parcimonie de délicates jambes de bois. Ici, les boutonneux d’élite qui composent l’équipe de campagne paraissent animés d’une haine tenace, et leur arrogance n’en finit pas de nous surprendre.
Alors que nous prenons place dans l’allée où doit s’engouffrer Monseigneur pour son apparition sur scène, une horde de t-shirts blancs nous assaille et nous invite à regagner notre coin. Ou plus exactement, nous ordonne. Dès lors, ça commence à gueuler fort, quelques-uns se demandent à voix haute s’ils n’auraient pas mieux fait d’aller au cinéma. Rien n’y fait, les ordres sont formels, et leurs exécuteurs d’une rigidité cadavérique. Il vient alors à l’un d’eux une idée exquise. S’adressant aux vigiles du Zénith, sombres costumes, cheveux grisonnants et trapèzes verticaux, il leur suggère de se mettre à genoux au passage de Macron, pour nous faciliter le travail. Sur ma gauche, le type de la sécurité semble un tantinet inquiet, quand d’une voix mielleuse, je lui dis à quel point je vais me faire plaisir de le photographier agenouillé devant un financier. Un éclair de lucidité traverse son regard, et remonté, il me lance : « Moi, je m’agenouille devant personne ! » Son collègue acquiesce. Par oreillettes interposées, l’équipe de campagne échange avec inquiétude sur la fronde qui ne cesse de monter.

Soudain, prenant tout ce beau monde au dépourvu, Macron surgit dans une magnifique cohue. La foule, pas du genre à entrer en transe, n’en attend pas moins une guérison des écrouelles au contact de son héros. Dans la bousculade, entre les gros bras de la sécurité et les frêles t-shirts blancs des recrues de Macron, deux ou trois photographes seulement parviennent à prendre une photo à la volée. Ça se met à fuser dans tous les sens, le public s’en mêle.
« C’est un scandale ! Bordel, on peut pas travailler !
– Mais tu vas fermer ta gueule, putain ?
– Toi, d’abord tu me tutoies pas. Puis tu vois pas que je veux juste bosser ? »
Rapidement, les photographes finissent pourtant par se disperser, sans incident majeur, histoire de varier les angles et tenter de subtiles compositions avec une luminosité minable. Un petite groupe se terre dans une allée en contre-plongée, traquant les meilleurs gestes de Manu. Un t-shirt blanc lui demande timidement de regagner les rangs. Refus poli. Grésillements d’oreillette. Arrivée d’un t-shirt blanc de grade supérieur. Nouvelle requête, plus proche de la menace. Tout en rigolant, quelqu’un sort de quoi enregistrer le son, avant de lâcher : « Maintenant, que ça soit clair, je vais pas bouger ! Je reste le temps d’avoir mes images. Si vous voulez me virer, faites le par la force, ça fera plaisir aux caméras derrière moi ! » Le bonhomme semble vaincu et repart. Mais revient aussitôt avec quatre nouveaux sbires, plus costauds que la moyenne, faisant au passage trébucher une consœur qui se fend en retour d’une petite douceur verbale. Le volume sonore de l’échange qui s’en suit est suffisant pour que Macron s’interrompe quelques secondes et observe la scène. Un vigile finit par intervenir, chope un t-shirt blanc par le col et lui déclare : « La sécurité, ici, c’est moi. Ils ne passent pas la ligne. Laissez-nous faire notre travail et eux le leur ! » Les t-shirts blancs capitulent définitivement, non sans affecter quatre des leurs à la surveillance particulière de l’amie de Camille, dont le caractère méditerranéen ne leur a pas échappé.
La tension retombe. La foule boit les paroles de son tribun, dissertant sur les centaines de personnes qui n’ont pu rentrer et que pourtant nous n’avons pas vues. L’attachée de presse tente de nous faire la morale et est aussitôt prise à partie par d’autres photographes. Plus distrayante est la pathétique tentative d’excuse d’une autre, terrorisée à l’idée que nous ayons enregistré tous les échanges. Je me fais le plaisir de lui montrer un enregistrement en cours. Quelques hésitants hourras accueillent de temps à autres les variations sémantiques de Macron, dont les paroles se perdent dans l’immensité d’une salle à moitié vide. Nous décidons de nous replier chez nous.
Au final, une bien étrange soirée. Outre la consternante médiocrité de la petite bourgeoisie provinciale, il m’a été donné l’occasion de voir une sorte de solidarité prolétarienne s’installer entre de balaises vigiles et de freluquets photographes que tout oppose, provisoirement réunis par le mépris avec lequel ils ont été traités. On a beau cultiver une infinie suspicion à l’égard de tout ce qui porte un uniforme et fait exécuter des lois et des règlements, on a tout de même trouvé sympathique cette fraternisation ponctuelle contre une poignée de donneurs d’ordres.
Pour d’autres aventures de Jack Alanda, visitez son blog.